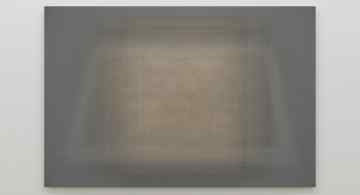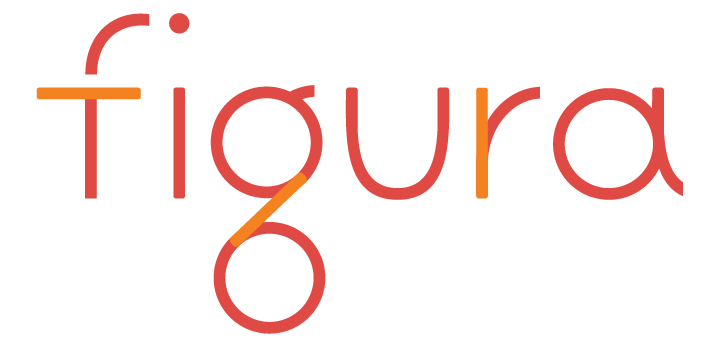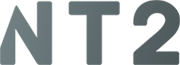Dans un article portant sur l’incipit de Bonheur d’occasion (Gabrielle Roy, 2009 [1945]), Pierre Popovic pose quelques remarques qui clouent le cercueil au vieux rêve du grand roman d’amour québécois. En affirmant, dans un clin d’œil à André Gide, que les « gens heureux n’ont pas d’histoire » et « n’ont pas plus de littérature » (1999: 22), Popovic ajoute, en commentant le titre on ne peut plus prosaïque de Bonheur d’occasion : « Un roman dont le titre serait Florentine Lacasse à la recherche du bonheur ne pourrait être qu’un roman sentimental ou qu’un roman édifiant appartenant à la paralittérature. » (23) Autre manière d’avancer que la littérature consacrée ne pourrait se permettre que des fins tragiques ou nostalgiques, depuis que le roman moderne a fait peser sur le bonheur personnel « tout le soupçon qu’il a pu, quand il ne l’a pas tout bonnement rejeté avec mépris. » (23)
Allant au-delà du préjugé selon lequel la fin heureuse serait réservée au roman paralittéraire (ce qui nierait absurdement toute légitimité à l’œuvre d’une Jane Austen ou d’une Charlotte Brontë), le présent article vise à mettre en dialogue l’imaginaire amoureux du roman canonique et du roman sentimental de masse au Québec1. Après avoir abordé l’hypothèse selon laquelle le roman d’avant 1960 serait rétif à l’amour, nous examinons, dans un second temps, les manifestations du désir chez quelques héroïnes iconiques de la littérature québécoise. Dans la dernière partie, nous entendons montrer que les romans sentimentaux paralittéraires de l’après-guerre présentent des aspirations semblables aux romans retenus par le canon, notamment en ce qui a trait au rejet de la misère matérielle et au sort traditionnellement réservé à la mère canadienne-française. Selon nous, qu’au bout du compte l’amour triomphe ou non a peu d’importance en soi, si les deux corpus s’inscrivent, pour les héroïnes, dans une même parenté discursive.
De ladite hypothèse
Dans les années 1950, ignorant superbement la production populaire, la critique littéraire commence à s’inquiéter du fait que l’imaginaire peine depuis un siècle à produire de véritables histoires d’amour au Québec. En 1954, Monique Bosco écrit : « Il n’y a pas de vrais romans d’amour au Canada, il n’y a que des romans où l’on voudrait aimer. » (1951: VIII) Six ans plus tard, c’est au tour du critique Jean Le Moyne de relever comment les lettres québécoises font se succéder des histoires d’« amour empêché », d’« amour interdit », d’« amour puni » et d’« amour sali » (1957: 33). En 1960, dans une charge qui ne souffre nulle exception, Claire Martin affirme que l’amour n’a jamais été que « le problème parent pauvre de nos romans » (20). Et Martin de conclure : « Il n’y a pas à dire, l’amour n’est pas aimé dans nos lettres. Il est mal portant, il a les dents courtes et se décrépit vite. » (20)
Le propos de Bosco, Le Moyne et Martin est repris dans les mêmes années par plusieurs chercheuses et chercheurs. En 1964, André Renaud résume l’idée que l’on se fait alors de l’amour dans les lettres québécoises : « Les héros recherchent l’amour sans conviction, s’y abandonnent sans bonheur et le rejettent souvent avec désillusion. » (186) Renaud conclut son texte en affirmant : « Inlassablement, nos récits romanesques disent des amours compromises par quelque aspiration obscure de l’esprit ou, ce qui est plus grave, par un état d’inquiétude, de névrose ou de désarroi moral. » (188) Paul Gay réitère ce jugement dans son mémoire de maîtrise, déposé la même année à l’Université d’Ottawa (1964). Dans une analyse qui embrasse à la fois le XIXe et le XXe siècle, Michel Van Schendel confirme cette impression d’un échec du thème amoureux, échec qu’il attribue à la situation de colonisés dans laquelle les autrices et auteurs seraient empêtrés. La sclérose de l’amour dans le roman ne serait ainsi que la transposition de l’aliénation collective des Québécoises et Québécois (1964: 163). Enfin, dans son étude du personnage féminin au sein du roman féminin canadien-français, de 1884 à 1966, Suzanne Paradis arrive au même constat (1966: 321).
Le désamour de l’amour dans le roman québécois d’avant les années 1960 est une idée tenace. Aujourd’hui, ce lieu commun n’a pas complètement perdu de sa force et l’on continue souvent de poser la prémisse d’une absence d’aventures amoureuses, quand ce n’est pas d’aventure tout court (Daunais, 2015), dans les premiers temps de la littérature québécoise. Mais la question nous semble mal posée. Plutôt que de se demander pourquoi le roman québécois d’avant la Révolution tranquille condamne les élans amoureux, il est plus opportun d’observer quelles formes prennent ces élans amoureux avant d’être refoulés ou sublimés.
De Rose à Florentine. Des sujets désirants
Corsetée par divers impératifs (moraux, religieux, nationalistes, patriarcaux), la quête amoureuse est, nous le reconnaissons, peu valorisée dans le roman québécois d’avant 1960. Comme le code de l’amour-passion fait du sentiment amoureux quelque chose qui se suffit à lui-même, étant à lui-même sa propre loi (Luhmann, 1986), il autorise d’une part les unions les plus improbables et les plus condamnables du point de vue de l’ordre dominant (dans le cas qui nous occupe, des unions entre francophones et anglophones, ou entre catholiques et protestants, par exemple), et il favorise d’autre part un repli des amoureux sur leurs seules subjectivités (« les amoureux sont seuls au monde »), ce qui se traduit par la volonté de fonder une famille et non de prolonger une lignée. Cette qualité subversive de l’amour le rend suspect aux yeux des élites traditionnelles, qui encouragent la diffusion d’un discours romanesque prescriptif afin de refouler (par une insistance sur la raison ou le devoir), de discréditer (par un diagnostic de folie, de fièvre ou d’aveuglement) ou de sublimer (par une canalisation vers la patrie ou la religion) la passion. Il demeure que de multiples stratégies narratives ont été utilisées pour contourner les limites morales fixées à l’expression de la passion dans le roman québécois (Saint-Martin, 2018). L’érotisme affleure dans certains passages qui montrent que les héros ne sont pas indifférents aux atours des femmes qu’ils côtoient et que les héroïnes ne sont pas insensibles aux charmes « virils » des hommes qu’elles fréquentent (Salaün, 2010). S’intéressant à la mise en récit des désirs féminins dans Angéline de Montbrun (Laure Conan, 1882), Virginie Fournier a ainsi souligné l’importance des motifs de la flamme et du feu de foyer, qui permettent une érotisation subtile des corps (2018).
Dans cette perspective, il serait intéressant de poursuivre l’analyse en se penchant sur Maria Chapdelaine, l’une des grandes figures de l’amoureuse éplorée. Pour peu que la focalisation soit placée sur elle, on constate que Maria, par l’entremise du discours indirect libre, incarne bel et bien un sujet désirant. En fait foi la scène où, en pleine nuit, elle surveille la cuisson du pain et où la lueur du four — récurrence du motif de la flamme — fait surgir chez elle une rêverie amoureuse. Elle imagine alors François Paradis (qui n’est pas encore mort) revenu des chantiers, lui faisant la cour. À cet instant, Maria n’admet pas la possibilité de renoncer à la passion. Elle refuse d’accepter ce que lui dicte « la voix », qui évoque pour elle une vie de privation et d’ennui :
Il lui semble que quelqu’un lui a chuchoté longtemps que le monde et la vie étaient des choses grises. La routine du travail journalier, coupée de plaisirs incomplets et passagers; les années qui s’écoulent, monotones, la rencontre d’un jeune homme tout pareil aux autres, dont la cour patiente et gaie finit par attendrir; le mariage, et puis une longue suite d’années presque semblables aux précédentes, dans une autre maison. C’est comme cela qu’on vit, a dit la voix. Ce n’est pas bien terrible et en tout cas il faut s’y soumettre; mais c’est uni, terne et froid comme un champ à l’automne. (Hémon, 1988 [1913]: 80-81)
Le jugement posé par Maria sur ce renoncement à l’amour est non-équivoque :
Ce n’était pas vrai, tout cela. Maria secoua la tête dans l’ombre avec un sourire inconscient d’extase, et songe que ce n’était pas vrai. Lorsqu’elle songe à François Paradis, à son aspect, à sa présence, à ce qu’ils sont et seront l’un pour l’autre, elle et lui, quelque chose frissonne et brûle tout à la fois en elle. (81)
Même si le récit ne permet pas l’éclosion finale de l’amour, le point de vue de Maria n’a pas changé à la fin du roman, une fois François Paradis disparu. Forcée de choisir entre deux prétendants qu’elle n’aime pas, Maria se sent « pareille à une élève debout sur une estrade devant des yeux attentifs, chargée de résoudre sans aide un problème difficile. » (153) Or, tout eût été « facile » si François avait été vivant : « Elle n’aurait pas eu à se demander ce qu’il lui fallait faire : elle serait allée droit vers lui, poussée par une force impérieuse et sage, aussi sûre de bien faire qu’une enfant qui obéit. » (153) Maria, à qui ne se présente pas d’autre choix que de se marier, continue d’éprouver un besoin d’aimer, tout en sachant qu’elle ne peut plus obéir à l’amour et doit maintenant se soumettre au devoir.
Si le roman québécois d’avant 1960 réprime les élans du cœur, la « faute » n’en est donc pas attribuable aux personnages féminins esquissés par les auteurs et les autrices, qui les montrent comme des êtres désirants et se languissant pour une relation passionnée. Ce sont les « instances jugeantes » du récit (Harel, 2005) qui minorent leur point de vue, dressant sur le chemin de leurs affections premières des obstacles insurmontables qui obligent les personnages (féminins ou non) à revenir à la « hiérarchie essentielle des choses qui comptent » (121), pour reprendre l’expression de Louis Hémon. La démonstration d’une telle censure pourrait être facilement poursuivie par l’analyse de toutes ces histoires dans lesquelles des héroïnes risquent énormément (que ce soit leur bonheur, leur honneur ou leur vie) à ne pas renoncer à leurs penchants amoureux au nom de la raison ou du devoir (Rannaud, 2018).
La littérature québécoise d’avant 1960 ne tait donc pas totalement l’expression de l’amour féminin, même si elle est sans cesse détournée et métaphorisée. Et si elle ne la tait pas, ce n’est pas uniquement parce que le désir charnel fait constamment irruption dans le récit. La passion irrépressible et spontanée (comparée à un coup de foudre) est aussi régulièrement associée, chez les héroïnes, à une aspiration à un certain confort matériel, pour ne pas dire un confort matériel certain. Dans la quête amoureuse mise en scène dans le corpus, le cœur et le corps sont mobilisés d’une façon différente pour l’homme et pour la femme. Pour l’homme, davantage autorisé à fantasmer sur la beauté plastique de sa promise, la perversion de l’amour prendra à son extrême la forme du lucre (la femme pouvant être pour lui un simple objet sexuel), ce qui conduira, pour dédouaner l’homme de ces appétits « bestiaux », à l’écriture de plusieurs passages sur la gentilhommerie des héros et la beauté « angélique » des héroïnes. Pour la femme, la perversion de l’amour prendra à son extrême la forme du luxe (l’homme pouvant être pour elle le moyen d’une ascension sociale), ce qui donnera lieu à maints passages sur le caractère pur et désintéressé des héroïnes (Luneau et Warren, 2022). Pour l’héroïne, le héros est promesse d’aventure et de sécurité, l’autonomie du sentiment amoureux dans la société moderne (« vivre d’amour et d’eau fraîche ») étant paradoxalement liée à la nécessité de trouver un bon parti. Autre manière de dire que l’amour est aussi une affaire d’argent pour les personnages féminins, à l’image de ce que Mary-Catherine Harrison observe dans la littérature américaine et britannique (2014).
À ce sujet, il est révélateur qu’une fois écarté François Paradis, mort dans la forêt, Maria Chapdelaine songe à suivre Lorenzo Surprenant dans la mesure, précise-t-on, où le rêve américain peut lui offrir une « compensation » pour son amour perdu : « L’amour, — le vrai amour — avait passé près d’elle […] et maintenant elle se prenait à désirer une compensation et comme un remède l’éblouissement d’une vie lointaine dans la clarté pâle des cités. » (Hémon, 1988 [1913]: 155) Même après l’intervention de la voix, Maria continue de rêver aux « merveilles » de la ville, aux « larges rues illuminées », aux « magasins magnifiques », à « la vie facile, presque sans labeur, emplie de petits plaisirs ». À défaut d’amour, Maria voudrait à tout le moins vivre l’aventure. Et c’est sur une interrogation, loin d’une certitude, que se referme le débat intérieur de Maria : « Mais peut-être se lassait-on de ce vertige à la longue […]? » (195) Avec François Paradis, elle n’aurait pas eu à choisir : sans être aussi riche que Surprenant, il avait « de l’argent en masse » (4) comme trappeur et, planifiant de se « trouver une “job” comme foreman dans un chantier », il était assuré de gagner de « grosses gages » (71). Quant à Gagnon, bien qu’il ne soit pas riche, il prend tout de même le temps de souligner qu’il a deux lots « tout payés » (148) et que lorsqu’il reviendra des chantiers, au printemps, il n’aura « pas moins de deux cents piastres dans [s]a poche, clair. » (149)
Cette relation inavouable de l’amour et de l’argent remonte aux origines du roman québécois. Rose Latulipe, telle que décrite dans L’influence d’un livre (1837) d’Aubert de Gaspé, n’est-elle pas elle-même envoûtée par cet amalgame de richesse et d’amour2? Devant le beau collier de « vraies perles » que fait miroiter sous ses yeux le diable, elle se voit prête à désobéir à son père et à ignorer les injonctions de sa vieille tante bigote (Gaspé, 1995 [1837]: 62). L’instance jugeante du récit, le vieillard qui raconte l’histoire au passant, la disqualifie d’ailleurs : Rose, « qui aimait beaucoup les divertissements », passe pour une fille « scabreuse, pour ne pas dire éventée » (60). Elle sera punie par la mort, quelques années après son enfermement au couvent.
Nous pourrions multiplier les exemples de cette association, parfois discrète, parfois manifeste, entre amour et argent. Mentionnons seulement, cent ans plus tard, le personnage de Florentine Lacasse qui, à l’instar de Sophie Brown, l’héroïne de « Cendrillon ’40 » (Gabrielle Roy, 1940), pense à l’amour en y distillant un rêve d’ascension sociale. Pour Florentine, Jean Lévesque est un intercesseur susceptible de la tirer de la misère (Morency, 1997), dans une aspiration qui se rapproche de celle de Rose Latulipe et, pour peu qu’on y prête attention, de celle de Maria Chapdelaine. À peine peut-on dire que, par rapport à ces dernières, Florentine rêve à l’amour d’une manière plus désenchantée, étant consciente de la dimension matérialiste de sa quête amoureuse :
Il sembla à Florentine que, si elle se penchait vers ce jeune homme, elle respirerait l’odeur même de la grande ville grisante, bien vêtue, bien nourrie, satisfaite et allant à des divertissements qui se paient cher. Et soudain, elle évoqua la rue Sainte-Catherine, les vitrines des grands magasins, la foule élégante du samedi soir, les étalages des fleuristes, les restaurants avec leurs portes à tambours et leurs tables dressées presque sur le trottoir derrière les baies miroitantes, l’entrée lumineuse des théâtres, leurs allées qui s’enfoncent au-delà de la tour vitrée de la caissière, entre les reflets de hauts miroirs, de rampes lustrées, de plantes, comme en une ascension si naturelle vers l’écran où passent les plus belles images du monde : tout ce qu’elle désirait, admirait, enviait, flotta devant ses yeux. (Roy, 2009 [1945]: 19)
Ainsi, amour et argent sont très souvent complémentaires dans le corpus canonique, surtout lorsqu’ils passent par le prisme des désirs de l’héroïne. Les personnages féminins veulent aimer, et leur amour est mû à la fois par le cœur et l’intérêt. Une trame semblable traverse les collections sentimentales écrites et publiées au Québec dans l’après-guerre, ce qui confirme encore une fois l’impasse consistant à mettre dos-à-dos littérature légitimée et paralittérature. Comment s’étonner que les tenants du « désamour de l’amour » dans le roman québécois se soient accrochés à cette hypothèse, puisque le roman sentimental québécois paralittéraire n’a jamais été convoqué à la barre des témoins?
Le roman sentimental de l’après-guerre. Les conditions du bonheur amoureux
Pour la période allant de 1940 à 1965, François Hébert a répertorié pas moins de 11 000 fascicules écrits et publiés au Québec (2012: 13). Au sein de cette masse, les collections « Mon roman d’amour », « Roman d’amour mensuel », « Roman d’amour spécial », « Les plus belles histoires d’amour », entre autres, donnent à lire au grand public une variété impressionnante d’histoires sentimentales. Les Éditions Police-Journal occupent la part du lion de ce marché effervescent, lançant un roman par semaine qui, contrairement à ce qui se passe pour Rose, Maria et Florentine, promet à l’héroïne le grand amour au terme du récit3. L’examen de ce corpus jusqu’ici trop peu exploré s’impose : non seulement ces romans font, sans surprise, triompher l’amour, mais ils entrent en dialogue avec le corpus canonique, en présentant des héroïnes aux aspirations semblables. Cela est particulièrement frappant dans le cas de Bonheur d’occasion (Gabrielle Roy, 1945), Le Survenant (Germaine Guèvremont, 1945) ou Poussière sur la ville (André Langevin, 1953) — et nous pourrions allonger considérablement cette liste —, ouvrages contemporains des romans de Police-Journal. Une étude comparative générale des romans paralittéraires et des œuvres canoniques mériterait d’être poursuivie. Restons-en pour le moment à deux points de convergence entre ces textes : l’alliage, dans la recherche de l’amour, de la quête érotique et de la quête matérialiste.
En ce qui concerne l’érotisme des romans à dix sous, nous serons brefs. Qu’il suffise de dire que la séduction féminine, dans un marché matrimonial élargi, est nettement plus déterminante dans l’après-guerre que par le passé. Se déroulant presque toujours en ville, ces romans mettent en scène une héroïne qui doit trouver l’amour hors de son cercle immédiat : sa beauté demeure, à cette fin, son meilleur atout. On décrit ses yeux brillants, ses lèvres chaudes, ses jambes fines et sa taille élancée. Par le corps de l’héroïne sourd un érotisme latent (qui ne doit toutefois pas basculer dans le racolage qu’affiche la vamp, son contre-modèle), érotisme passant surtout par le regard du héros en proie au désir.
La célébration de la richesse est aussi plus franche dans les romans à dix sous que dans le corpus légitimé. Certes, en conformité avec un amour qui ne saurait jamais être intéressé, les héroïnes qui tentent de gravir les échelons de l’ordre social en exploitant un homme qu’elles n’aiment pas seront vertement punies, mais, pourvu que l’amour soit au rendez-vous, aucun frein ne viendra ralentir les aspirations au luxe de la jeune épouse. Marjolaine, dans Le hockey et l’amour, négocie elle-même pour son mari un lucratif contrat avec le Canadien de Montréal : grâce à cette intervention inopinée, le jeune joueur gagnera 20 000$ par saison. Et Marjolaine pourra s’offrir le beau manteau « de mouton de Perse », annoncé par « un grand magasin de Montréal » (Loslier, ca 1957: 15), dont elle rêvait depuis longtemps.
Cette quête de richesse de l’héroïne n’est pas toujours motivée par le rejet de sa classe sociale d’origine. On trouve dans notre corpus quantité d’épigones de Cendrillon qui fuient la misère de leur famille en épousant leur patron. Néanmoins, ce scénario n’est pas plus fréquent que celui d’une héroïne déjà financièrement à l’aise, qui déménage avec son mari dans une demeure encore plus somptueuse d’Outremont. C’est à notre avis moins contre sa classe sociale que contre le modèle fourni par sa propre mère que l’héroïne embrasse un nouveau destin. À propos du roman québécois écrit par des femmes, Lori Saint-Martin remarque que les mères y sont soit mortes (et leur souvenir, dans ce cas, est peu important dans le récit), soit vivantes mais discréditées : « Le roman au féminin reprend à l’infini le refus de la vie que mène la mère. » (2017: 66-67) Or ce refus de s’accommoder d’un rôle maternel peu enviable, cette « matrophobie », qui n’est pas, comme le rappelle Saint-Martin, la peur de la mère, mais bien la peur « de devenir comme sa mère » (68), traverse aussi le roman sentimental à 10 sous.
Ce que répètent les héroïnes de Police-Journal, c’est à quel point elles ne veulent pas ressembler à leurs mères, coincées dans le rôle servile de reproductrices et de domestiques. On aurait pu penser que la naïveté du rêve amoureux charrié par les textes publiés par les Éditions Police-Journal irait de pair avec une acceptation joyeuse de la maternité traditionnelle, mais il n’en est rien. D’abord, les héroïnes qui sont mères sont très peu nombreuses dans le corpus des Éditions Police-Journal. Le récit prend généralement fin au moment où les héroïnes, alors très jeunes (guère plus de vingt ans), obtiennent le baiser des fiançailles. Le récit est consacré au déploiement des fréquentations qui, elles, sont excitantes, parce qu’elles se déroulent au cinéma, dans les salles de danse et autres endroits « fashionable », évoquant une sorte de voyage de noces qui aurait lieu avant le mariage. Si jamais les héroïnes ont de jeunes enfants, c’est parce que l’on souhaite, pour renouveler un peu l’intrigue, soit aborder un topos qui fascine dans l’immédiat après-guerre (le phénomène de la fille-mère), soit explorer les premières années de ménage d’un jeune couple. Dans ce dernier cas, on voit très peu l’héroïne en relation avec sa progéniture, débordée qu’elle est à régler ses problèmes de cœur, la véritable affaire du roman sentimental.
À cet égard, le roman Souffle de passion de Betty Forest est original par sa représentation des rapports mère/fille. On y retrouve la jeune Ruth Miron, forcée par sa mère à accomplir, en tant qu’aînée, différentes besognes dans la maison : « Ruth se révoltait, mais elle savait l’inutilité des révoltes. Depuis longtemps qu’on réclamait son aide, elle savait qu’elle ne faisait que commencer. Avec toute la nichée, madame Miron avait besoin qu’on l’aide. » (Forest, 1947: 2) C’est sans ardeur que Ruth se livre aux tâches ménagères : « Cuisiner, coudre, repasser, et quoi encore! » Sa mère a beau lui faire valoir que cet apprentissage lui sera utile une fois mariée, Ruth se rebiffe : « Pendant un an encore elle les accomplirait ces travaux multiples et ennuyeux et la perspective d’être un jour mariée et femme accomplie comme maîtresse de maison n’aidait en rien à l’enthousiasme du moment. » (5) Après des études pour devenir dactylo, Ruth croit trouver un peu d’excitation dans le travail, mais cela n’est que de courte durée. Elle doit remettre son salaire à sa mère, qui, du reste, lui accorde peu de liberté pour sortir. Un soir, Ruth rencontre Claude, qui fait vibrer son cœur, mais il part aussitôt à la guerre. Par dépit, dans un geste qui n’est pas sans rappeler celui de Florentine à l’égard d’Emmanuel Létourneau, Ruth épouse Marcel, un homme bon mais malade et ennuyant. Elle s’installe avec lui en banlieue, savourant un bonheur d’occasion. Similaire à la description qu’en donnera pour les États‑Unis Betty Friedan dans The Feminine Mystique (1963), la vie est si morne pour Ruth que
quand Marcel rentrait, fourbu après une journée de travail, qu’elle le savait las à mourir, alors elle aurait voulu mourir elle aussi, couchée parmi les fleurs du parterre, la face enfouie dans le gazon tout autour et les deux mains sur les oreilles pour ne point entendre battre jusque dans le tympan son cœur fatigué et malheureux. (Forest, 1947: 17)
Étonnamment, c’est la mère de Ruth qui, constatant la fatigue de sa fille, vient confirmer l’incompatibilité entre bonheur amoureux et tâches domestiques trop éreintantes. Après lui avoir conseillé de penser davantage à elle-même et de se reposer, la mère renie en quelque sorte la valeur édifiante de la vie qu’elle a menée : « Je sais… Je dis des choses que moi-même je n’ai pas su mettre en pratique toujours… mais vous étiez six! Quand je n’avais que deux enfants, je trouvais le tour parfois de me faire cajoler… » (19) Madame Miron énonce les balises acceptables pour que naisse le bonheur au foyer dans les années 1950 : il faut que la morale ancienne du renoncement à soi (au nom des enfants ou par devoir envers le mari) soit remplacée par celle du soin de soi (« se faire cajoler », au moins dans la fiction). La mort de Marcel et le retour de Claude arrangent bien les choses pour Ruth : dans sa maison de banlieue, elle retrouve, grâce à son remariage, l’ivresse des soirs de fête.
L’héroïne du fascicule sentimental doit arriver à un délicat équilibre : elle ne doit pas être trop carriériste, car on ne lui permet pas encore de tourner le dos à l’amour et à la maternité. Les vieilles filles ont une destinée peu enviable, quand elles ne s’arrangent pas pour avoir auprès d’elles des enfants de substitution (Joubert et Hayward, 2000). En même temps, alors que s’efface la quête mystique ou patriotique qui a pu, par le passé, fournir un autre débouché au don de soi de l’héroïne, il s’agit plus que jamais d’atteindre le bonheur dans le couple, mais un couple « moderne », dont la finalité n’est plus la revanche des berceaux, le salut de la « race », la reproduction d’une lignée ou la conservation d’un patrimoine. L’héroïne est encouragée à se marier, sous la promesse qu’elle trouvera dans le foyer conjugal un espace à elle où, malgré les tâches qui lui seront confiées, elle sera « reine ».
La jeune héroïne des Éditions Police-Journal s’invente un nouveau rôle, qui tend vers celui joué par Florentine Lacasse sans tout à fait l’épouser, et s’éloigne de celui incarné par Maria Chapdelaine sans parvenir à le nier absolument. Or cette recherche d’une nouvelle façon d’exister au féminin donne lieu parfois à des discours surprenants de franchise, comme cette héroïne qui s’exclame, au début d’un roman : « Il y a trop d’hommes qui s’imaginent que la femme n’est qu’un outil dans le ménage et qu’elle sert uniquement à faire des petits. Mon mari ne pensera pas ainsi, c’est moi qui te le dis. » (Zéphire, 1952: 4) Maria Chapdelaine ne pouvait tenir un tel propos, tout en écoutant ses prétendants lui parler de leurs « gages » et de leurs « piastres », promesses d’une vie relativement à l’abri du besoin, à défaut d’un avenir plus glorieux. Les héroïnes des Éditions Police-Journal n’ont plus cette retenue : il est entendu qu’elles épouseront, par amour, un homme riche.
***
Plus que la réussite ou l’échec de l’amour dans le roman, ce sont les conditions de sa réalisation ou de son empêchement qu’il importe de scruter pour comprendre les aléas du cœur dans la littérature québécoise d’avant les années 1960. Pour passer du statut de jeune fille à celui de femme, l’héroïne du roman (paralittéraire ou non) doit se marier, ce qui pose la question de son éveil amoureux. On trouve ainsi maints passages, feutrés ou non, où les rêveries sentimentales des héroïnes (de Rose à Ruth, en passant par Maria et Florentine) laissent entrevoir des désirs voluptueux. Ce premier constat sur la présence de la passion s’accompagne d’un deuxième : dans les romans, les héroïnes cachent mal le caractère intéressé de leurs attirances. Tant dans le corpus canonique que dans la littérature populaire, elles ne cessent d’entremêler quête de l’amour et recherche d’un certain confort. Amour et richesse convergent vers un même but : faire du foyer conjugal autre chose qu’une condamnation de la femme à des tâches serviles (Fournier, 2005). Grâce à l’affection et la fortune de son mari, l’épouse sera cajolée et gâtée, vivant une éternelle lune de miel (dans les bras de son amoureux attendri et attentionné) et un éternel voyage de noces (symbolisé par les sorties et les évasions diverses que lui laissent ses nombreux loisirs).
Tant du point de vue affectif que financier, littérature canonique et paralittérature convoient le même message, avec seulement une force différente et, en conséquence de cette modulation, des conclusions contrastées : dans la littérature canonique, la minorisation de l’expression de la passion autorise sa canalisation vers des impératifs extérieurs (lignée, patrie, religion), alors que, dans la paralittérature, la fin heureuse est celle de l’amour triomphant, que rien ne peut contenir ou dévier. Dans le roman d’amour en fascicules, cette obligation de l’amour heureux libère en particulier l’héroïne de trop lourdes responsabilités maternelles. L’amour n’est plus celui, sacrificiel, d’une mère entourée d’une ribambelle d’enfants, dont Rose-Anna Lacasse est à la fois l’incarnation parfaite et le repoussoir. Avec deux ou trois enfants tout au plus, l’héroïne des Éditions Police-Journal échappera au poids d’une maternité écrasante et pourra « trouv[er] le tour parfois de [s]e faire cajoler ». Si Maria n’a pas été en mesure de tourner le dos au modèle traditionaliste incarné par sa mère, Ruth, elle, le pourra, après son remariage. Son amour pour ses enfants n’aura pas à compenser son manque d’amour pour son mari.
Non, l’amour n’est pas mort-né dans le roman québécois. L’histoire du roman québécois nous enseigne que l’amour y a toujours été présent. Seulement, l’évolution culturelle des époques qui l’ont vu naître l’a constamment obligé à changer de forme et de force. Sa plus grande constance, toutefois, demeure d’avoir allié de manière intemporelle et insécable le cœur et l’argent, dans une association plutôt étonnante pour un peuple à qui on a voulu faire croire qu’il était « né pour un petit pain ».
- 1. Nous entendons par là, dans le reste du texte, le roman francophone et nous parlerons ici de littérature « québécoise » même si, avant les années 1960, le corpus était désigné comme « canadien-français ».
- 2. Sur les origines et l’essor de cette légende, voir Le Diable à la danse de Jean Du Berger (2006), qui recense 500 versions.
- 3. Dans le cadre du projet « De l’amour à 10 sous », nous avons lu plus d’une centaine de romans sentimentaux publiés par les Éditions Police-Journal, lecture dont nous synthétisons ici les résultats. Pour plus de détails, consultez le site du projet.