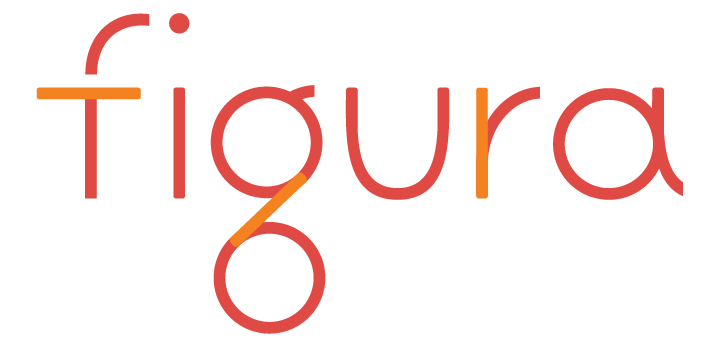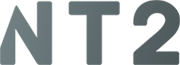[J]’ai découvert dans ce livre […] un piège qui
se referme silencieusement sur son lecteur
insouciant qui ne saura peut-être même
pas qu’il a été piégé, tel est l’art de l’écrivaine1.
D’une part, il y a « la mort de l’auteur » déclarée par Barthes (1968); d’autre part, la renaissance de l’auteur dans les « autofictions ». Entre les deux, il y a des fictions qui problématisent la présence de l’auteur et qui, finalement, en viennent à revendiquer son ascendance même dans son absence, autobiographique ou narrative. Il s’agira ici, après un détour par deux exemples bien connus, de sonder quelques romans québécois des dernières décennies afin de voir en quoi la problématisation de la source du récit, à l’intérieur même de la fiction, infléchit le parcours du lecteur ou bien le mène dans des impasses logiques et interprétatives2.
Un courant récent dans la critique littéraire s’intéresse au phénomène de l’immersion du lecteur dans la fiction qu’il lit et à la conscience scindée qui caractériserait l’état d’immersion, surtout devant des fictions qui semblent adhérer aux conventions du réalisme romanesque : tout en sachant qu’il lit de la fiction, le lecteur se laisse emporter dans le monde fictif, y « croit ». Mais dans un mouvement contraire, certaines fictions mettent en évidence leur pouvoir sur le lecteur, ne serait-ce que pour mieux le piéger, lui révélant de façon brutale ou bien subtile qu’il s’est fait avoir. Comme le constatent Frances Fortier et Andrée Mercier : « l’adhésion au raconté est délibérément mise en procès par des modalités inédites d’instauration et de contestation du pacte romanesque » (2011a: 8). Nous explorerons alors la théorie de l’immersion fictionnelle dans le contexte de quelques récits dont les dispositifs métatextuels semblent mettre à mal les pactes de lecture, en particulier la relation de connivence et de complicité entre lecteur et écrivain et le pacte de la « feintise ludique partagée » (Schaeffer, 1999: 19).
Immersion fictionnelle et pactes de lecture
Avant d’aborder notre corpus, situons les effets que nous visons à cerner. L’exemple de « La continuité des parcs » de Julio Cortázar servira à illustrer l’effet d’immersion et la rupture du pacte de la « feintise ludique partagée ». Le récit met en scène un lecteur qui s’immerge dans un roman et se plaît à « s’éloigner, petit à petit » (Cortázar, 1973: 87) de sa réalité environnante, tout en gardant la conscience de ses alentours immédiats — les cigarettes à son côté, le velours vert du fauteuil où il est assis. Cette demi-conscience ne lui permet pourtant pas de s’apercevoir que le personnage meurtrier de la fiction qu’il est en train de lire vient de s’introduire dans son salon et s’apprête à l’assassiner3. Caractérisé par Marie Laure Ryan comme « allégorie de l’immersion fictionnelle4 » (2001: 165-167), le récit de Cortázar évoque explicitement l’emprise de la fiction sur le personnage lecteur et souligne, à l’instar de Jean-Marie Schaeffer, que l’immersion fictionnelle n’est jamais totale, mais implique un « état mental scindé » (1999: 190). L’immersion dépend d’une relation de connivence entre le lecteur et l’auteur dans laquelle les deux s’accordent pour reconnaître la fiction comme une « feintise ludique partagée » (189) : c’est le partage qui distinguerait la feintise ludique de la feintise sérieuse et ainsi la fiction du mensonge ou de la supercherie. Or nous proposons que, par un retour sur la notion même de pacte, et donc de partage, certaines fictions quittent le domaine du ludique pour verser plutôt dans celui de la supercherie.
Tel est le cas de « La continuité des parcs » : tout en annonçant l’état partiel de l’immersion du lecteur fictif, le récit de Cortázar semble en quelque sorte l’infirmer du fait que l’emprise de la fiction sur le personnage lecteur est si intense que la fiction lue l’emporte sur le réel et devient non seulement « réalité », mais réalité dangereuse. Le récit démolit le confort de la supposée connivence partagée censée régir le rapport entre le lecteur et la fiction : à l’insu du lecteur-victime, la fiction se transmue et envahit son réel, transgressant cette « frontière mouvante mais sacrée » (Genette, 1972: 245) qui sépare « un niveau (prétendu) réel et un niveau (assumé comme) fictionnel » (Genette, 2005: 31), aboutissant à ce que Genette qualifie de « métalepse » (31). Même le lecteur qui aurait intégré la métalepse à son répertoire de codes romanesques n’aurait pas vu venir celle-ci. Le lecteur réel est victime aussi, non pas d’un meurtrier, bien sûr, mais d’un auteur qui, au lieu de partager le lieu de la feintise, l’a dissimulée. Non seulement allégorie de l’immersion fictionnelle, alors, mais allégorie aussi de la fragilité du pacte de la lecture comme accord tacite entre deux instances de bonne foi : le lecteur, confortablement installé dans sa confiance en l’auteur comme dans son fauteuil, et l’auteur, agent franc et coopérant qui ne vise qu’à combler les attentes de son lectorat5.
Le pacte de confiance entre lecteur et auteur est fondamental au fonctionnement de la fiction : « En régime narratif, cette connivence essentielle passe par la reconnaissance des formes et des manières ainsi que par la “suspension volontaire de l’incrédulité” du lecteur dont parlait le poète anglais Samuel Taylor Coleridge » (Fortier, 2014: §4). L’adhésion est une posture sciemment adoptée par le lecteur. Le pacte de lecture suppose, derrière la voix narrative, un auteur empirique jugé au-delà du soupçon de la duplicité ou de la faillibilité qui pourraient justement caractériser le narrateur homodiégétique qui, lui, serait exposé aux faiblesses du commun des mortels : incompétence, ignorance, intérêt, mensonge. Si la littérature moderne a découvert les charmes du narrateur peu fiable, il faut bien noter que le pacte de la confiance sur lequel se base la fiction ne s’installe pas entre lecteur et narrateur — aussi hétérodiégétiquement infaillible qu’il puisse être —, mais bien entre lecteur et auteur, et ceci en dépit des rumeurs concernant la mort de ce dernier, qui auraient été « grandement exagérées6 » (Twain, 2006: 317).
Comme le récit de Cortázar le démontre, le pacte de la « feintise ludique partagée » s’avère, du moins dans certains récits, assez fragile : en effet, la feintise dans « La continuité des parcs » s’établit par le déploiement d’une narration aux allures réalistes sans la moindre trace de métafictionnalité ou de fantastique. Mais les choses se compliquent quand on quitte le lecteur fictif pour pénétrer avec lui dans la fiction qu’il lit, fiction « fictive » qui dote la première d’un degré de « réalité » à l’intérieur même de la fiction : deux niveaux ontologiques, pour ainsi dire, dont c’est le deuxième qui attire vers lui le lieu de la feintise. L’effet immersif de cette deuxième fiction est suffisamment fort pour « anéantir […] la conscience de la situation de feintise partagée » (Guelton, 2014: 80-81). Le partage établi dès le début (je suis en train de lire une fiction) est déplacé vers la deuxième fiction (le personnage est en train de lire une fiction), faisant oublier au lecteur que tout n’est que fiction. comme le disait Jean Ricardou,
ce qui, dans un texte, se prétend réel, n’est jamais qu’une fiction au même titre que ce qui s’y prétend fiction […] : on ne passe jamais que d’une fiction à une autre […]. La transmutation […] réveille donc, brutalement ou avec toutes sortes de subtilités encore plus efficaces, le lecteur qui rêve si intensément sur le texte qu’il prend les fictions pour des réalités. (1973: 121-123, cité dans Saint-Gelais, 1994: 230-231.)
C’est à savoir qui a triché. Dans le récit de Cortázar, la voix narrative hétérodiégétique, par convention fiable, ne semble rapporter que les faits fictifs, empiriques : il n’y a aucun narrateur homodiégétique non fiable, bouc émissaire pour endosser la culpabilité d’une tricherie, du piège dans lequel le lecteur tombe immanquablement.
Prenons un autre exemple célèbre où les pièges du texte ont été diversement mis sur le compte du narrateur et de l’auteur. Dans Qui a tué Roger Ackroyd?, Pierre Bayard entreprend une contre-enquête du roman d’Agatha Christie, Le Meurtre de Roger Ackroyd, pour démontrer que Poirot s’était trompé et que le coupable du meurtre était un autre. Pour sa part, quand Marc Escola ([s. d.]) relit la relecture de Bayard, c’est moins pour accuser de tricherie le docteur Sheppard (le narrateur menteur), ou de faillibilité Hercule Poirot (le détective sournois), mais plutôt Agatha Christie elle-même, de ne pas avoir respecté le pacte de l’honnêteté auctoriale en toute franchise. Derrière l’accusation d’incompétence dont Bayard accable le détective, il fallait évidemment lire la culpabilité de l’auteure :
Le problème dont l’absence m’apparaît criante dans ces pages [l’essai de Bayard] — y serais-je plus sensible que d’autres? — s’énonce naïvement ainsi : que devient dans cette affaire l’auteur du récit? Pourquoi n’inculpe-t-on pas Agatha Christie d’enquête bâclée, voire de trafic d’influence ou d’injure à magistrat? Car c’est une accusation en trompe-l’œil que celle qui tombe sur le petit détective belge, qui n’est pour rien dans une bévue dont la seule et unique responsable, à première vue comme à la réflexion, ne saurait être que la grande romancière britannique. […] Agatha Christie savait-elle, oui ou non, que le docteur Sheppard pourrait bien être innocent du meurtre de Roger Ackroyd? (Bellemin-Noël, 1998, cité dans Escola, [s. d.].)
Or, Escola accuse l’auteure directement, et cela, selon l’évidence des erreurs logiques internes à la structure narrative du roman :
on supposera qu’Agatha Christie a tout simplement hésité entre deux romans; ou plus exactement, qu’elle a cru pouvoir infléchir son dessein initial sans modifier l’ouverture du récit et sans consentir aux indispensables repentirs : si elle avait d’emblée songé à démasquer son narrateur dans le temps même de l’enquête, elle ne pouvait pas rédiger comme elle l’a fait la première page. Ira-t-on alors jusqu’à admettre qu’elle a rédigé une partie de son texte sans trop savoir comment elle allait le terminer et qu’elle n’a pas ensuite voulu revenir sur ses pas? À vrai dire, on a les meilleures raisons de le croire. (Escola)
Sur le plan de la logique narrative, le récit ne fonctionne tout simplement pas, si on lui impose la rigueur d’une enquête narratologique digne d’un Poirot…
Et pourtant, la fiction et sa supercherie fonctionnent merveilleusement bien, au point où le roman est devenu un modèle incontournable du genre et l’un des plus célèbres de tout temps. Bien sûr, du point de vue du lecteur innocent, c’est le narrateur, le docteur Sheppard, qui a menti tout le long; exemple sans égal du narrateur non fiable. Mais tout comme le lecteur fictif de Cortázar est victime du personnage du roman qu’il tient entre ses mains et ensuite de l’auteur qui a décidé de son sort, le lecteur du Meurtre de Roger Ackroyd est doublement victime : premièrement du narrateur, mais ensuite de l’auteure qui, consciemment ou par inadvertance, lui a jeté de la poudre aux yeux pour l’empêcher de voir les failles logiques du récit. C’est ainsi que dans ces deux exemples l’on voit surgir le spectre d’un auteur, non pas fictif mais réel, qui « triche » dans les coulisses de la narration.
Fictions et feintises dans le roman québécois
Nous allons mettre à l’épreuve le pacte de la « feintise ludique partagée » à l’aide de quelques fictions québécoises qui, au lieu de partager la feintise avec le lecteur, la lui dissimulent. La feintise devient par le fait même non pas ludique mais sérieuse : ce sont des fictions où le lecteur rencontre non pas un narrateur mais plutôt une narration trompeuse et, caché derrière elle, un auteur réel qui ne joue pas le jeu de la feintise partagée. Par la rupture des pactes de lecture les plus conventionnels, on ne produit pas de « vrais » romans mais… on ne pourrait guère parler de « faux » romans. Disons plutôt des « romans fictifs », où la rupture du pacte de la confiance entre l’auteur et le lecteur produit une feintise tout court, non plus partagée et donc ludique, mais sérieuse, projetant le roman dans le domaine de la supercherie, voire du mensonge. À l’instar de la pipe de Magritte qui n’en a que l’apparence, l’apparence du « roman » est un leurre; mais là où Magritte nous indique le lieu de notre méprise, le roman fictif nous le cache. À l’instar aussi du polar canonique, le lecteur est aux prises avec une énigme à résoudre, toutefois celle-ci ne se situe pas au niveau diégétique; c’est plutôt le roman lui-même qui la constitue (Saint-Gelais, 1997: 798).
Dans les cas que nous passerons en revue, l’opérateur fondamental de la feintise est la métalepse, transgression de la « frontière sacrée » entre les niveaux de la narration et du narré. Combinée avec une structure en boucle, cette stratégie produit ce que Douglas Hofstadter a défini comme des « boucles étranges » ou des « hiérarchies enchevêtrées7 » (1980: 10), qui sont amplement mises en scène dans de multiples dessins d’Escher, où le haut et le bas se rejoignent, où l’eau qui ne cesse de descendre remonte pourtant à son point d’origine. Le retour à la case départ est de l’ordre d’un fait apparemment avéré qui s’avère effectivement impossible dans le contexte de l’expérience humaine. On est pris dans un paradoxe irrésoluble : c’est comme si, sortant d’une pièce et montant un étage pour entrer dans une autre pièce, on se retrouve dans la pièce que l’on vient de quitter8.
Le double suspect de Madeleine Monette fournit un premier exemple relativement subtil de la rupture du pacte de la connivence. Anne, narratrice autodiégétique, est abandonnée à Rome par son amie Manon, qui décide d’aller rejoindre un amant en Allemagne. Mais Manon meurt en route dans un accident de voiture ayant toutes les allures d’un suicide. Anne hérite de son journal intime en même temps que de sa chambre d’hôtel, où elle s’installe et entreprend de transcrire le journal intime de Manon. Il émergera des efforts d’Anne non pas une mise en forme du journal, mais un véritable roman, car Anne est obligée de remplir les blancs dans le récit intime de Manon, moins par ses connaissances trop limitées de la vie de son amie que par les conjectures basées, parfois explicitement, sur ses propres expériences et sentiments. Difficile alors de distinguer entre la « vérité » du journal et la fiction romanesque. Mais, outre le peu de fiabilité de la notion de « vérité » tout court, il n’y a pas vraiment lieu de mettre en doute la bonne foi de la narratrice, ni ses bonnes intentions envers la mémoire de son amie. Elle avoue explicitement son ignorance de bien des aspects de la vie de Manon et ne cache pas la fictionnalité inhérente à son entreprise : autrement dit, une non-fiabilité affichée n’en est pas vraiment une. Ce qui semble pourtant établi, c’est qu’il y a du « réel » : en l’occurrence, une femme, Anne, occupant la chambre d’hôtel de sa défunte amie à Rome, où elle transcrit ses cahiers; et une « fiction », car sa « transcription » des cahiers de Manon comporte, elle l’admet, une bonne dose d’invention.
À la fin de son séjour italien, Anne rentre à Montréal et une voix narrative hétérodiégétique, sortie de nulle part, annonce qu’une femme descendait de l’avion, vêtue « en jean noir et pull rouge » (Monette, 1996 [1980]: 209). Ce détail anodin, dont la position en fin de récit assure pourtant la saillance, se retrouve à deux autres reprises dans le roman (178; 182). Ce « jean noir » et ce « pull rouge » sont les mêmes vêtements portés par Andrée, une amie de Manon qu’Anne n’a pas connue. En plus de rajouter aux multiples similarités érigées entre les personnages féminins, ce détail propose un autre problème : pourquoi et comment ces vêtements? Plusieurs explications venant du « régime de la représentation » (Saint-Gelais, 1994: 149) sont possibles, dont la plus efficace serait de prétendre que la narratrice, devant habiller le personnage d’Andrée, se serait inspirée de ses propres vêtements. Explication logique, mais peu satisfaisante sur le plan narratif : pourquoi cette saillance problématique? Une explication plus tordue privilégierait le régime de la transreprésentation9 en prenant la confusion d’identités entre la narratrice et le personnage fictif au premier degré : ce serait le personnage fictif Andrée qui descend de l’avion; Andrée est Anne, ou bien Anne est Andrée, et de toute façon Anne avoue elle-même qu’« Anne » n’est pas son vrai nom. C’est ainsi que fonctionne la « fiction fictive » : constater la fictivité de la narratrice est à la fois déroutant, le lecteur l’ayant dotée d’une « réalité » à l’intérieur de la fiction, et évident, puisqu’elle est personnage dans une fiction.
Cette logique métaleptique n’est pas sans faire retour sur d’autres éléments du récit. Le journal d’Anne, qui raconte son séjour en Italie après la mort de Manon ainsi que ses efforts de transcription, constitue le niveau du « réel » romanesque : les deux amies seraient « vraiment » allées en Italie, Manon serait « vraiment » partie en Allemagne et serait « vraiment » morte en cours de route. Le deuxième niveau, appelons-le « fictionnel », est la version du journal de Manon rédigée par Anne et qui constitue un « roman dans le roman ». Ici, plusieurs détails sont à noter : premièrement, le début du texte, le niveau « réel » donc, qui raconte les quelques jours passés à Rome avant le départ de Manon, est entièrement écrit par Anne après « la mort » de Manon. Autrement dit, dans le roman, Manon n’a de réalité que dans l’écriture d’Anne. Deuxièmement, Anne, en réfléchissant à son « roman », se demande si elle n’aurait pas dû commencer le récit à Rome (120). Or, le roman que nous lisons commence effectivement à Rome. Et, troisièmement, l’irruption de la voix hétérodiégétique à la fin situe l’ensemble carrément dans le régime du romanesque : la narratrice autodiégétique a disparu, donnant lieu à une autre voix située à l’extérieur du récit. Conclusion : le « roman » écrit par « Anne » n’est pas une version du journal de Manon, mais plutôt Le Double suspect — un roman qui, au lieu d’enchâsser un niveau narratif fictionnel en un niveau supposé réel, n’est fait que de la fiction : un roman fictif, si vous voulez10. En termes de métalepse, le niveau « où l’on raconte » et le niveau « que l’on raconte » se sont télescopés, les deux versant paradoxalement dans la fiction. Et puisque le roman est fictif, l’auteure l’est nécessairement : celle qui descend de l’avion à la fin du récit habillée de vêtements fictifs. Mais puisque roman il y a, il faut chercher ailleurs la source de la tricherie.
Dans Le sexe des étoiles de Monique Proulx et Hier de Nicole Brossard, on sommes confronte carrément à des situations métaleptiques qui tordent les mondes fictifs jusqu’à les rendre irrémédiablement paradoxaux. Difficile néanmoins d’accuser l’un ou l’autre narrateur de mauvaise foi. Dans le roman de Proulx, une voix narrative hétérodiégétique présente un monde absolument logique et vraisemblable, dépourvu des stratégies qui mettraient le lecteur sur la piste d’un roman métafictif. Est absent aussi un narrateur-écrivain en train d’écrire le roman que nous lisons. Ceci dit, les multiples effets d’ironie qui caractérisent la narration investissent celle-ci d’une subjectivité dont la source demeure incertaine. Parfois relevant d’une focalisation sur un personnage ou d’un type de monologue intérieur attribuable au personnage focalisé, l’ironie pourrait aussi être redevable à la voix auctoriale. Il y a effectivement un personnage écrivain, Dominique, auteur en panne qui essaie d’écrire un roman sur Marie-Pierre, une transsexuelle. Dominique devient fasciné par Marie-Pierre, voire amoureux d’elle, et vers la fin du récit, en traversant la rue pour la rejoindre, il se fait frapper par une voiture et meurt. Le manuscrit de 328 pages qu’il porte s’envole dans les airs à Montréal, et les pages atterrissent aux endroits dans la ville où les personnages avaient évolué dans le roman que nous lisons. Le roman de Proulx compte, évidemment, 328 pages. Et nous apprenons par le biais de Gaby, l’amie à qui Dominique avait confié une copie du manuscrit (et qui l’a fait publier sous son propre nom), que la dernière phrase de celui-ci est identique à la dernière phrase du Sexe des étoiles (Proulx, 1987: 324). L’auteur fictif du récit est révélé et mis à mort du même coup et tout le roman bascule dans la fictivité.
Mais à y regarder de près, les choses se compliquent encore : si Dominique est l’auteur du roman, c’est qu’il a écrit la scène de sa propre mort, laquelle a ensuite eu lieu. Et puisque le roman continue au-delà de sa mort, serait-ce Gaby qui l’a pris en charge? Et pourquoi, surtout, cette chasse à l’auteur dans les pages du roman quand le nom du coupable paraît clairement sur la couverture du livre? C’est que les énigmes du « roman fictif » nous l’imposent. Toujours selon Fortier et Mercier, parlant des romans qui affichent des « impossibilités pragmatiques » : « L’origine du récit devient dans ce cas une question posée par la fiction, sans véritable résolution » (2011b: 350). Tout comme dans Le Double suspect, le roman de Proulx soulève la question de son auteur (fictif) tout en nous privant d’une réponse adéquate. Encore une fois, il faut accuser l’auteure empirique de la supercherie qu’est ce « roman fictif ».
Hier de Nicole Brossard raconte la vie de quatre femmes, dont une romancière, mais à l’instar de Dominique, elle constitue un personnage au même titre que les autres et n’est pas donnée pour l’auteure du roman que nous lisons. Une narratrice autodiégétique raconte ses propres expériences, mais celles des trois autres personnages sont narrées en mode hétérodiégétique. À la fin du roman, les quatre amies se réunissent dans la chambre d’hôtel de la romancière, et là sont affichées sur les murs des pages du roman qu’elle est en train d’écrire. Les passages qui nous en sont donnés à lire proviennent, effectivement, de diverses parties du roman que nous venons de lire. Cette métalepse constitue alors une mise en abyme de la fictivité de la fiction, rappelant au lecteur ce qu’il devait savoir, mais ce qu’il aurait oublié : que la fiction n’est qu’une fiction, où il manque, notamment, une narratrice qu’on puisse accuser de non-fiabilité 11. Encore une fois, il faut retomber sur l’auteure empirique, laquelle nous a fait croire qu’on lisait un « vrai » roman. Par contre, selon une logique pour le moins tordue, le roman que nous lisons serait le fruit d’un personnage fictif qui n’a d’existence qu’à l’intérieur de la fiction que nous lisons (ou quelque chose d’approchant…) : un « roman fictif ». Le lieu précis de la supercherie commise est difficile à déterminer, mais la rupture du pacte de la connivence entre auteure et lecteur est certaine : c’est Nicole Brossard qu’il faut « accuser » d’avoir dissimulé la feintise, qui serait, selon la théorie de Schaeffer, non pas ludique mais sérieuse. La logique est impénétrable : une auteure fictive qui n’écrit pas le roman que nous lisons a écrit des passages du roman que nous lisons… Inutile — et trop difficile — de détailler plusieurs autres torsions à la logique représentationnelle qui habitent les dernières pages du texte : cette seule métalepse suffit pour faire basculer tout le roman dans le régime de la « transreprésentation », voire de la supercherie…
L’enterrement de la sardine de Patrice Lessard fournit l’exemple d’une fiction où l’auteur empirique s’affiche explicitement comme origine de la feintise qu’est le roman. Dans une préface signée « P.L. » (Patrice Lessard, nous supposons), l’auteur explique que son roman comporte deux textes distincts : le récit autobiographique de son séjour à Lisbonne et des chapitres d’un roman inachevé. Dans le texte, les deux parties intercalées sont distinguées par un système de titres de chapitres et d’astérisques.
Deux niveaux ontologiques, donc, au sein du roman : le niveau supposément « réel » (« autobiographique ») et celui désigné comme « fictif » 12. Pourtant, les personnages qui habitent chaque niveau ne respectent pas la frontière dite « sacrée » qui devrait les camper solidement dans leurs mondes respectifs : les personnages « réels » et « fictifs » passent allègrement entre les deux mondes.
La préface, lieu où réside normalement la « vérité » non fictionnelle, devient de plus en plus suspecte au fur et à mesure que les personnages de la « fiction » surgissent dans les parties du roman dites « autobiographiques » et vice-versa. Elle nous met en présence d’un auteur réel ou bien de son sosie, appelons-le P.L., qui ne joue pas le jeu, ou bien qui se paie notre tête par la manipulation des conventions les plus fondamentales de la fiction et qui, en outre, abuse de l’espace du véridique pour nous mentir13. C’est donc dans la préface, lieu de notre confiance aveugle en la bonne foi de l’auteur, que celui-ci triche : sans la qualification préfaciale d’« autobiographique », le roman se lirait comme une fiction dans une fiction, à l’intérieur desquelles les personnages auraient tous les droits de se promener comme bon leur semble — métalepse canonique, amusante mais ne dépassant pas les limites de l’acceptable romanesque. À la fin du récit, on trouve l’auteur « réel », un dénommé Patrice Lessard, installé dans la même chambre « merdique » (2014: 181) qui était précédemment le repaire de son personnage fictif. Si ce n’est pas littéralement la mort de l’auteur fictif comme dans Le Sexe des étoiles, c’est sa disparition dans sa propre fiction, que l’on peut qualifier d’« auctorophage ».
La revanche de l’auteur
Nous avons, donc, comme source de la feintise dissimulée : un auteur inconnu (Double suspect), un auteur mort (Sexe des étoiles), un auteur inexistant (Hier) et un auteur fictionnel (L’enterrement) — tous des masques d’un auteur réel, effronté et sans scrupules, qui se moque de son lecteur. Si ludisme il y a, ce n’est pas sur le mode du partage.
Il semble émerger au sein de ces fictions un nouveau lieu de soupçon : du régime de la non-fiabilité narrative régi ultimement par le pacte de la connivence entre lecteur et auteur, et par celui de la fiction comme « feintise ludique partagée », on est passé au régime de la feintise dissimulée et, par le fait même, à la feintise sérieuse, dont l’origine ne peut être que l’auteur réel puisqu’il y manque absolument un narrateur non fiable sur lequel faire retomber la culpabilité. Saint-Gelais nous conseillait de nous « méfier du texte » (1997: 798). Comment se méfier du texte sans se méfier de son créateur?
Ce phénomène est-il réellement nouveau? Aux époques pas si éloignées — pensons aux procès intentés contre Flaubert et Baudelaire, et plus récemment à l’affaire des Satanic Verses — l’auteur était tenu strictement responsable des déboires, voire des crimes de ses personnages. S’il ne s’agit pas ici de délits contre la moralité publique ou religieuse, on peut quand même constater, derrière le masque mortuaire porté par l’auteur contemporain (exception faite, nous l’avons dit, du genre « autofictionnel »), une résurgence de son autorité, de son emprise sur le lecteur. Hubert Aquin, que nous n’avons pas inclus dans ce survol mais qui y appartient en quelque sorte comme figure fondatrice en littérature québécoise, disait qu’il écrivait pour des lecteurs qui aimaient que l’on joue avec eux, ou encore, qu’il voulait « agresser » son lecteur (Boucher: 134). Voilà une prise de position claire et univoque que pourraient endosser l’ensemble des auteurs que nous avons étudiés, et d’autres encore.
Si l’image d’une pipe n’est pas une vraie pipe, l’apparence d’un roman ne fait pas non plus un « vrai roman ». Ou bien c’est un roman qui affiche sa fictivité, et non seulement sa littérarité comme dans les cas classiques des romans métafictifs, donc un « roman fictif ».
Devant l’absence d’un personnage narrateur que l’on peut accuser de ruses, d’erreurs ou de feintises, le soupçon doit fatalement retomber sur l’auteur réel. Naguère instance suprême détentrice de la vérité, du moins en ce qui concerne son texte, il a ensuite succombé à la disparition — critique, comme le voulait Roland Barthes, ou bien fictive, comme c’est le cas dans nos romans. Des cendres de ces morts théoriques et littéraires semble renaître une troisième figure auctoriale. Assumant à la fois la toute-puissance du premier (l’auteur empirique) et l’absence du deuxième (l’auteur fictif), c’est un dieu qui ne se dévoile que par son pouvoir manipulateur sur la bonne foi du lecteur. Rusé, tricheur, ce nouvel auteur se joue de son lecteur non pas de manière ludique, comme le veut le « pacte de la feintise partagée » qui est censé régir la fiction, mais plutôt de manière sérieuse. La fiction apparente est un leurre derrière lequel se dissimule le véritable lieu de la feintise, piégeant le lecteur dans des paradoxes sans issue.
On pourrait bien se demander, au-delà du plaisir de la mystification que produisent de tels récits, quel serait le sens ou la signification de ces supercheries. Nous avons dit qu’Hubert Aquin fait figure, pour nous, de fondateur de ces énigmes romanesques au Québec. Dans son dernier roman, inachevé, il déclare : « Tous les artifices de l’intrigue ne feront jamais oublier au lecteur que derrière cet écran de décombres se cache une pauvre loque qui se prend pour Dieu » (1981: 16). Melikah Abdelmoumen (2012) renchérit à propos de ce texte en écrivant que l’« auteur du livre que nous tenons, frémissants de plaisir coupable, entre les mains, aura toujours, et même à la énième relecture, l’avantage sur nous. Et le dernier mot. » Ce jugement porté sur Aquin peut aussi valoir pour les auteurs des romans que nous avons sondés. Si tous les auteurs ne se qualifient pas, bien sûr, de « pauvres loques », jugement porté sur Aquin par Aquin, ceux que nous avons étudiés s’octroient pourtant le statut de dieu : dieu naguère détrôné, mis à mort et enterré, le voilà de retour derrière l’écran des artifices de l’intrigue, pour affirmer son ascendance sur le lecteur et pour avoir le dernier mot.
- 1. Turgeon, David. 2014. La Revanche de l’écrivaine fantôme. Montréal : Le Quartanier, p. 84-85.
- 2. Nous tenons à distinguer d’emblée notre objet d’étude du romancier fictif ou de « l’écrivain imaginaire », figure importante dans le roman québécois depuis 1960 et étudiée en détail par Roseline Tremblay (1995), notamment. Bien que présentant tous des personnages de romanciers, les romans que nous examinons ne tendent pas à en faire la source probable ou possible de la fiction; ils posent la question de l’identité de l’auteur plus directement, entre autres à travers l’instance du narrateur. Plutôt que l’auteur fictif, ce sont les traces évanescentes de l’auteur réel qui nous intéressent.
- 3. C’est le velours vert du fauteuil du lecteur et de celui de la victime qui assurent l’identité des deux personnages.
- 4. [Nous traduisons.]
- 5. Cette coopération et les attentes qui l’accompagnent ne valent évidemment que pour des récits affichant un degré de vraisemblance suffisante pour susciter un niveau minimal d’immersion. De telles fictions dissimulent leur véritable nature sous des apparences trompeuses — à l’encontre des textes hermétiques, surréalistes, et certains Nouveaux romans, par exemple, qui rompent dès le début avec les pactes pouvant susciter une lecture immersive.
- 6. « The report of my death was an exaggeration » (2006: 317), a déclaré Mark Twain au journaliste Frank Marshall White dans une entrevue accordée au New York Journal en 1897. [Nous traduisons.] Notons qu’il n’est pas question dans le présent article du genre de l’autofiction sauf, à la limite, sous une forme détournée, voire feinte.
- 7. [Nous traduisons.]
- 8. « The “Strange Loop” phenomenon occurs whenever, by moving upwards (or downwards) through the levels of some hierarchical system, we unexpectedly find ourselves right back where we started. […] I use the term Tangled Hierarchy to describe a system in which a Strange Loop occurs. » (Hofstadter, 1980: 10.)
- 9. Saint-Gelais (1994) propose le terme « transreprésentation », dérivé de Ricardou, pour désigner des dispositifs narratifs qui « rompent non seulement avec l’illusion référentielle » mais qui, en privilégiant les « marques de surface » sur les « contenus propositionnels », mettent en œuvre une « problématisation de la représentation » : selon Ricardou, « la représentation est mise en procès : en marche et en crise » (1973: 231-232).
- 10. La dernière réplique du roman : dans une conversation imaginée entre la narratrice et ses amis qui attendent son retour à Montréal, on lui demande ce qu’elle écrivait pendant son séjour. Elle répond : « Un roman?… Oui, si vous voulez… » (Monette: 209.)
- 11. Fortier et Mercier parlent dans ce cas de « narration indécidable » qui « peut être aussi bien attribuée à la technicienne en documentation muséale [la narratrice autodiégétique] qu’au personnage de l’écrivaine Carlson, et ce, sans véritable résolution » (2011b: 335). Cette indécidabilité nous semble constituer une absence de narrateur, source du récit.
- 12. Sans les effets métaleptiques, on pourrait croire à un véritable texte d’autofiction qui enchâsse un roman inachevé. Pour une discussion plus détaillée du roman, voir Randall (2017).
- 13. Contrairement aux préfaces fictionnelles problématisant l’origine auctoriale ou narrative du récit, lesquelles soulèvent la question « qui est l’auteur? », la préface signée « P.L. » a l’effet contraire de renforcer l’identité entre l’auteur empirique (Patrice Lessard), le préfacier (P.L.), et le personnage narrateur (Patrice Lessard). Sur les préfaces fictionnelles, voir Bélanger et Bérard (2014).