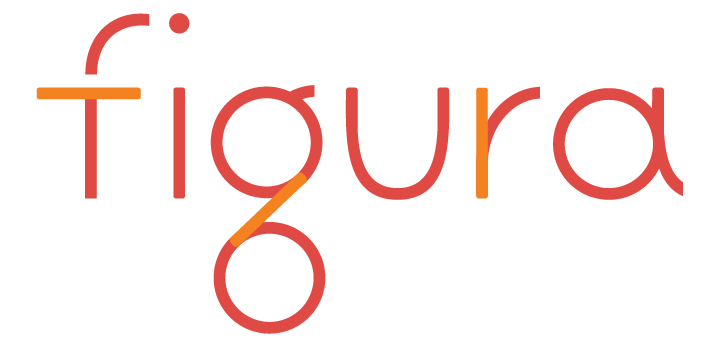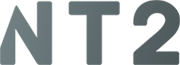indiquer cette fraction de la scène
qui supporterait l’impression générale
Michael Delisle1.
En 1934, alors qu’il a dix-sept ans, Sàndor F. se fait offrir une chevalière avec ses initiales par son ami lors d’une cérémonie de fin d’études. Dix ans plus tard, en 1944, il se retrouve dans un wagon à bestiaux en direction d’Auschwitz, entre la Hongrie et la Pologne, sur le point de mourir des coups reçus par un SS. À l’intérieur du wagon, avant de mourir, Sàndor F. tend la main à un de ses confrères pour lui donner sa chevalière, dans l’espoir que cet homme survive et qu’il puisse rendre la bague à un membre de sa famille. Six ans plus tard, en 1950, sur une terrasse de café de Tel-Aviv, la sœur de Sàndor, Lenke, entend des hommes parler hongrois à la table voisine. Elle aperçoit une chevalière aux initiales SF, portée au doigt d’un des hommes, qu’elle interroge sur la provenance de celle-ci : « Pour toute réponse, l’homme pleure en silence. Sans parvenir à reprendre son souffle ni articuler un mot, il pleure. » (Fleischer, 2009: 392.) L’homme, qui est un rescapé d’Auschwitz, et qui était bien dans le wagon avec Sàndor F., fond en larmes, voyant devant lui « l’improbable destination d’un lointain message » (392). Alain Fleischer est né en 1944, trois mois avant la mort de son oncle Sàndor F. En 1964, le jour de ses vingt ans, il se fait offrir la chevalière en question par sa tante Lenke.
Cette histoire, elle est disséminée dans le roman Moi, Sàndor F. que j’entends ici analyser. Au terme de la lecture se pose évidemment la question de sa véracité. Est-ce que tout cela est vrai? Hors du texte, Fleischer soutient que oui; il l’affirme notamment dans un entretien accordé à Josyane Savigneau (2011: 8)2. Ainsi, j’ai choisi en ouverture de cet article de reconstituer, avec des repères temporels — en plaçant l’oncle mort d’un côté et le neveu vivant de l’autre — une histoire que le roman nous donne, lui, en éclats. Cette reconstitution ici incontournable a nécessairement l’effet d’aplanir le rapport à la vérité et au temps dont l’œuvre joue et se joue d’une manière poétique et complexe. Le présent article entend toutefois rendre justice à la narration de ce roman en dévoilant et en interrogeant ses principaux ressorts. Si Moi, Sàndor F. présente une narration non fiable, ce n’est pas pour tromper le lecteur, mais parce que l’entreprise poétique qu’elle engage répond à la « nécessité » de transmettre une histoire trouée (Fleischer cité par Savigneau: 8)3. Nous avons donc ici une écriture ambiguë par nécessité subjective et formelle où se superposent les sujets et les temps sans toutefois gommer l’écart les séparant. Il s’agira ici d’exposer les différentes modalités de la narration de Moi, Sàndor F., afin de reconnaître la spécificité de cette écriture qui mêle les « je » de plusieurs sujets, de plusieurs époques; qui mêle le souvenir et l’imagination. Ensuite, l’analyse de certaines récurrences textuelles servira à révéler comment l’événement imaginé de la mort de l’oncle devient le matériau principal pour construire le récit de sa vie au sein d’une circularité particulière — manœuvre allant à l’encontre de l’écriture biographique ou historique traditionnelle. Enfin, nous montrerons comment Fleischer fait appel à son propre savoir historique et culturel pour étoffer le « je » du texte, qui n’est finalement pas seulement celui de Fleischer et de Sàndor, mais aussi celui d’Egon Schiele, peintre autrichien celé au creux du roman.
Trois leitmotivs
Le texte met donc en scène un oncle, né en 1917 à Budapest, mort en 1944 en direction d’Auschwitz, ainsi qu’un neveu auquel l’auteur s’identifie, né en 1944 à Paris. L’œuvre superpose ces deux subjectivités au sein d’un seul « je » qui s’énonce du lieu d’un wagon en direction d’Auschwitz, quelques minutes ou quelques heures avant sa mort; un « je » qui possède un savoir sur sa mort à venir et sur la Shoah, parce qu’il est aussi le « je » d’Alain Fleischer né en 1944 à Paris et toujours en vie au moment de l’écriture, mais que le texte nomme aussi Sàndor F. Cette superposition se présente ainsi dans le roman :
Moi, Sàndor F., né à Budapest en 1917, je suis […] le personnage d’une autobiographie — je dis bien autobiographie, et non biographie — dont l’auteur, Sàndor F. — toujours moi, donc —, est né à Paris en 1944. De moi, Sàndor F., des années de ma brève existence, de ma fin misérable et anonyme, que peut connaître Sàndor F., et qui est-il lui-même pour s’intéresser à un destin aussi obscur, qui devient le sien dans cette œuvre autobiographique, à moins que tout cela ne relève du roman? Que le lecteur n’aille pas déduire de ce qui précède qu’il y a deux Sàndor F., un vrai et un faux […]. C’est un peu différent : il y a deux « moi » qui se succèdent pour un seul Sàndor F., deux époques dans l’histoire d’un même être […]. Il y a celui que j’ai été, mort à vingt-sept ans, sans avoir eu le temps de raconter ma vie, et qui maintenant, par cette écriture autobiographique, se prolonge dans celui qui écrit. Il y a celui qui aurait dû continuer à vivre et qui, dans cette autobiographie que j’écris à sa place, devient celui que j’aurais pu être. (Fleischer, 2009: 10-11.)
Le don de la chevalière évoqué en ouverture est raconté à la toute fin du roman et se présente comme l’événement qui scelle, à rebours, les deux « je » — de l’oncle et du neveu :
En m’offrant cette bague pour mes vingt ans, ma tante Lenke devient ma sœur, qui me restitue la chevalière, qui me rend mon prénom, qui me le donne, qui m’apprend qui je suis, qui me raconte mon histoire, qui me rapporte les circonstances de ma fin, qui m’apprend ma mort, qui me dit ma réapparition, qui m’explique comment tout cela est lui parvenu, à la faveur du hasard le plus invraisemblable. (Fleischer: 385-386.)
Le texte est saturé de mentions du type « Moi, Sàndor F. né à Budapest en 1917 » et « Moi, Sàndor F. né à Paris en 1944 ». Elles ne servent pas à placer le savoir du neveu d’un côté et l’invention de l’autre — laquelle surgirait quand l’oncle décédé prend la parole. Au contraire, elles creusent l’ambigüité, puisqu’elles sont parfois employées dans un même souffle, au sein d’une même phrase :
Moi, Sàndor F., né à Budapest en 1917, j’aurais pu connaître celui que je suis en ce moment, Sàndor F., né à Paris en 1944, et si tout nous rapproche au point de nous confondre en un seul et même être, ce qui nous sépare en deux destins différents, en dépit de la continuité, reste sans solution, sans remède. (Fleischer: 376.)
Cette superposition des deux subjectivités a pour effet de démultiplier la filiation. Si on prend le texte au pied de la lettre, on se retrouve avec au moins quatre Sàndor, ce qui donne lieu à des affirmations improbables où le narrateur soutient par exemple être « arrivé sur terre trois mois avant [s]a mort » (Fleischer: 23). Tout se passe comme si l’œuvre produisait des subjectivités, au risque de l’invraisemblance (c’est peu dire), pour nier, refuser, déjouer la mort advenue. À toutes les disparitions des membres de la famille imposées par les événements de la Shoah (les parents de Sàndor sont morts également dans les camps), le texte répond avec un procédé narratif où les voix se redoublent; sorte de tentative « de réparer, de restituer, de remplacer, de restaurer, de repeupler le monde pour qu’il semble complet à nouveau » (57-58). Puisque les deux Sàndor « parlent » en même temps, mais de deux endroits dans l’arbre généalogique, chaque membre de la famille se voit dupliqué. Lorsqu’il est question de Lenke, il s’agit à la fois de la sœur et de la tante du « je »; lorsqu’il est question de Karoly, il s’agit du frère et du père. La narration assume cette multiplication des subjectivités au lieu de la résoudre : « Moi Sàndor F., né à Budapest en 1917, j’ai eu deux frères : Karoly, mon père, dont je viens de parler, et Béla, l’aîné, mon oncle, et j’ai eu une sœur, Lenke, ma tante, tous trois plus âgés que moi. » (32.)
Aussi faut-il mentionner qu’au lieu de raconter l’histoire de son oncle au conditionnel, Fleischer insère plusieurs « Je me souviens. J’imagine » dans le récit de Sàndor. Ces segments sont présents plus d’une centaine de fois et se déclinent de plusieurs façons : « Je ne me souviens plus » (Fleischer: 12); « Je ne sais plus, je n’ai jamais su. J’imagine. Je me souviens » (47); « Je m’en souviens, je le vois (48); « J’imagine, je ne sais plus, mais je suis sûr pourtant » (283); « Tout cela, moi […] je le sais, je l’ai su, je m’en souviens, j’imagine, et puis je l’ai appris » (117); « J’imagine que je crois. Je crois que j’imagine » (191); « Je ne sais plus, je ne sais rien, je me souviens quand même. J’imagine » (285-286). Se retrouvent sur un même plan le souvenir, l’invention et l’imagination. Si la narration de Moi, Sàndor F. est suspecte et ambigüe, il ne semble pas que son auteur cherche délibérément à nous tromper, car le procédé est ouvertement discuté tant dans le texte qu’hors de celui-ci. Cette non-fiabilité ne trompe pas, donc, mais elle confond. Cette confusion est le fruit d’une tentative de dire l’histoire en parlant depuis une mémoire non vécue. Comment transmettre une histoire n’ayant jamais été contée? Comment produire un discours sur l’événement sans qu’il soit formaté par les modalités de l’écriture historique, d’autant que celle-ci ne reconnaît pas toujours la part d’invention inhérente qui la caractérise4? Comment transmettre quelque chose de plus que les anecdotes familiales « presque amusantes » (Fleischer: 339) que Fleischer juge incomplètes et dénaturées? Dans son passé, le père de Fleischer — celui de Sàndor F. dans le texte — ne raconte en effet que les péripéties insignifiantes ou les fins heureuses, « ne retenant que le comique et la joie élémentaire pour protéger le chagrin dans le silence et l’oubli » (Fleischer: 93).
Représenter la Shoah
En outre, ce rapport complexe à la mémoire pourrait être désigné de « postmémoire », tel que le propose Marianne Hirsch, terme qui désigne
la relation que la « génération d’après » entretient avec le trauma culturel, collectif et personnel vécu par ceux qui l’ont précédée, il concerne ainsi des expériences dont cette génération d’après ne se « souvient » que par le biais d’histoires, d’images et de comportements parmi lesquels elle a grandi5. (Hirsch, 2014: 205.)
Ce sont les implications poétiques de cette postmémoire qui nous intéressent ici. Recourir à la littérature pour répondre aux différentes questions énoncées plus haut n’est pas toujours vu d’un bon œil et engendre certaines polémiques. Pour le dire avec Dominique Viart, « [c]e ne sont pas tous les ouvrages consacrés aux camps qui sont regardés avec suspicion, mais ceux qui s’en approchent avec les moyens de la littérature » (2010: 26). Le chercheur remarque dans les années 2000 le surgissement d’un corpus de littérature concentrationnaire qui « instal[le] [la fiction] au cœur même du scrupule qui l’entrave » (2010: 276). Chez Fleischer on peut concevoir l’aveu constamment répété (« je me souviens, j’imagine ») comme ce scrupule entravant le texte et lui donnant sa forme inédite. L’œuvre préfère l’invention au silence et se construit en répondant à sa manière aux questions qui la tenaillent.
Moi, Sàndor F. est publié dans une collection intitulée « Alter Ego », dont l’objectif est de proposer des autobiographies fictives7. Le procédé est donc reconnu, encouragé par un éditeur et le livre ne passe pas pour un objet étrange dans le paysage littéraire — déjà en 1987, Pierre Pachet publiait Autobiographie de mon père. Ce procédé engendre toutefois différentes polémiques, la plus connue étant celle qui oppose Claude Lanzmann à Yannick Haennel, le premier accusant le second de falsifier l’histoire en se mettant dans la peau de Jan Karski dans son roman du même nom (2009), tantôt applaudi8, tantôt qualifié de « misère d’imagination9 » (Lanzmann, 2010: 6), de « faux témoignage » (Wieviorka, 2010: 30) et de « régression historiographique » (Wieviorka, 2010: 30). Si la publication de Moi, Sàndor F. n’a vraisemblablement engendré aucune polémique, c’est sans doute parce que l’existence que Fleischer présente — et trahit du même coup, en l’inventant — se rattache à sa propre filiation et concerne l’histoire d’un inconnu du public, contrairement à la mise en fiction d’un personnage historique comme Jan Karski. Les deux romans adoptent néanmoins des procédés narratifs similaires.
Représenter l’événement de la Shoah ou ce qui l’entoure suscite la suspicion et, à une époque où l’art multiplie les moyens de négocier avec le réel, il apparaît encore plus difficile pour une œuvre fictionnelle portant sur la Shoah de faire consensus. C’est pourtant l’exploit que semble avoir réalisé László Nemes avec son film Le fils de Saul, paru en 2015 — qui a même reçu « l’approbation10 » de Lanzmann (Blottière, 2015) — et qui n’a pas laissé Fleischer indifférent. Fleischer a fait paraître un essai intitulé Retour au noir (2016), qui répond de manière parfois un peu frondeuse à l’ouvrage Sortir du noir (2015) de Georges Didi-Hubermann, lequel encense le film en question. Fleischer s’y interroge notamment sur la force du consensus entourant Le fils de Saul et se demande ce qui le justifie, croyant pour sa part que ce film « d’ailleurs estimable, appartient de façon au moins aussi problématique et critiquable que ses prédécesseurs aux productions de l’industrie culturelle [et] […] cinématographique » (Fleischer, 2016: 34). Fleischer en a contre cette idée que l’on aurait trouvé le régime de représentation adéquat de la Shoah, nous permettant enfin de passer à autre chose dans l’histoire du cinéma :
En effet, on ne peut manquer d’éprouver, face à ce consensus pratiquement sans faille, le sentiment inconfortable qu’il marque la fin d’une époque de la critique cinématographique, en saluant enfin le chef-d’œuvre artistique irréprochable, la conclusion enfin trouvée — ouf! — d’un chapitre de l’histoire du cinéma : celui consacré à la Shoah. (36.)
Est-ce que le consensus tient sur le cadrage choisi par Nemes et dont les critiques font l’éloge, qui présente le protagoniste en gros plan tout au long du film et brouille le reste de l’image, obscurcit les horreurs? La représentation idéale de la Shoah serait-elle « pudiquement flou[e], prudemment flou[e], esthétiquement flou[e] », se demande Fleischer (61)? Et « pour éviter quelle indécence? » (61.) Sans répondre à la question, on peut signaler qu’à sa manière, le roman Moi, Sàndor F., même s’il est un texte écrit, n’est pas dans la représentation picturale et dévoile ses différents jeux et ressorts, souligne ses mensonges, prend le parti de l’impudeur.
Ainsi Fleischer fait le choix surprenant de raconter, d’inventer la vie de son oncle à travers un prisme bien précis, celui de ses expériences sexuelles, son éveil érotique, ses fantasmes. Il met en récit la première relation sexuelle de Sàndor, à treize ans, avec Anett, une employée de la famille qui en a quinze, tout en avouant, bien sûr, l’invention : « Moi Sàndor F., je n’ai pas connu Anett, et je n’ai pas connu Sàndor F. Je ne sais si Anett a existé. » (183.) Fleischer met également en scène différents moments où Sàndor est ému devant le corps nu de sa sœur Lenke, et il laisse planer, sans le raconter, un épisode de transgression incestueuse entre sa sœur et lui11. Sur le plan éthique, on pourrait se demander pourquoi un tel choix de Fleischer. Trahit-il la mémoire de son oncle en lui inventant une histoire incestueuse? Il s’agit plutôt de reconnaître, sur un plan poétique, qu’avec les moyens de la littérature, il tente — ce sont les mots du texte — de « rectifier et corriger l’Histoire » (Fleischer: 13), laquelle tend à exclure de son récit la dimension sexuelle et intime. Cela dit, le récit de Fleischer se déploie selon une logique bien particulière qui n’est pas seulement celle de l’impudeur, logique qu’il faut maintenant exposer.
La circulation des signifiants
Fleischer met à mal l’idée commune d’une mémoire exclusivement liée à l’expérience, et son livre nous convainc que le temps de la mémoire n’est pas le temps de l’Histoire, qu’il adopte plutôt une circularité; le passé est à l’intérieur du texte pensé comme un refoulé qui fait retour et contamine l’écriture. Loin de refermer la mémoire sur elle-même, la circularité dont il est question ici est celle d’une « revenance » de l’événement, causée par son intensité particulière. Pour le dire avec les mots de Pierre Ouellet :
C’est la « pressance » ou la persistance d’une préséance, donc, qui agit dans ce type de temporalité, où prévaut la « revenance », soit la réverbération et la résonance de l’événement dans la non-contiguïté des faits ou des époques, puisque la fréquence d’un phénomène ou d’un acte n’implique pas la continuité historique, mais, au contraire, la rupture brusque et la résurgence violente, l’urgence du « revenant » après un long temps de latence ou de patience, soit le pressant, […] qui sous-tend le présent pluriel dont se compose toute expérience, toute « épreuve » étant imprégnée par ce qui fut et impressionnée par ce qui sera. (Ouellet, 2012: 150.)
Les quelques signifiants qui font retour dans le texte de Fleischer ne sont pas simplement des thèmes abordés par l’auteur, lesquels serviraient à donner au récit une couleur; il faut plutôt les concevoir comme des éclats d’événements, des ondes de choc, bref, ce par quoi on arrive à percevoir l’événement — la « dernière image » (Fleischer: 13) — dans son épaisseur et sa persistance. L’événement de la mort de Sàndor, tel qu’il est raconté, devient donc le matériau à partir duquel Fleischer invente une vie à Sàndor. Cette fin, plutôt que d’être présentée comme un point d’inconnue sur lequel on ne pourrait rien dire est non seulement décrite en détail, mais elle contamine l’histoire de l’oncle, son passé. À un déroulement linéaire de l’histoire qui confinerait l’événement à un passé inaccessible, Fleischer oppose une parole vivante qui inscrit l’événement dans le présent de l’écriture :
Je sais que je dois renoncer à tout ordre, à toute chronologie, à tout déroulement linéaire depuis un début jusqu’à la fin. Car la fin est au milieu de tout, elle est ce point noir qui irradie et vers lequel tout afflue, par lequel tout passe, trou noir qui éclaire tout ce qui précède, celui que j’ai été, et ce qui suit, après la fin, celui que je suis. (Fleischer, 2009: 23.)
Quels sont les termes de la mort de Sàndor? La narration dit de Sàndor qu’il est mort dans un wagon à bestiaux entre la Hongrie et la Pologne, qu’il a reçu un coup d’un officier SS et qu’il se trouve couché « à plat ventre comme un nageur » (Fleischer: 325) sur le sol du wagon au moment de sa mort; qu’il a aperçu un appareil Leica au cou d’un SS; que son corps est recouvert d’ecchymoses; que la puanteur et la proximité des autres hommes est invivable; que la soif et la déshydratation envahissent les corps environnants. Chacun de ces éléments constituent un point de départ de l’histoire racontée de l’oncle. Au bleu des ecchymoses, le texte oppose une vie sous ce signifiant du bleu, qui aurait été la couleur favorite de Sàndor. Fleischer évoque le bleu du papier à lettres sur lequel aurait écrit Sàndor (25); le bleu de l’encre (25), le bleu pâle des murs de la maison familiale (89, 110, 218), maison entourée de tilleuls « dont l’ombre était bleue » (27). Il est aussi question du bleu de son manteau : « Ma main droite, piétinée par le soldat, est inerte et bleue — cette couleur que j’aime tant commence à envahir mon corps, signe d’une dernière faveur qui m’est accordée : être tout entier gagné, accueilli, par ma couleur favorite […]. » (Fleischer: 325.)
L’assemblage des signifiants de la mort imaginée paraît parfois plus crypté. La narration présente un souvenir d’enfance, par exemple, où le jeune Sàndor se serait amusé à faire passer les rails de son train électrique sur les sépultures de ses animaux de compagnie :
Je me plaisais à faire passer les rails près des endroits du jardin où j’avais enterré solennellement un poisson rouge, un merle, notre petite chienne bâtarde et, dans mon esprit, je rendais ainsi hommage à ces animaux que j’avais tant aimés, dont la mort avait été la source de mes premiers chagrins inconsolables. (Fleischer, 2009: 226-227.)
Mort dans un wagon à bestiaux se transforme, dans cette scène, en une représentation d’un wagon roulant sur des bêtes mortes. La réorganisation des signifiants de la mort sert à construire un épisode de l’enfance de l’oncle.
Le récit de la première relation sexuelle de Sàndor, avec Anett, qui a lieu dans un lac de Chodova Plana, en Bohème, fonctionne sur le même mode. À la promiscuité dérangeante des corps d’hommes dans le wagon, le texte oppose la proximité sensuelle de Sàndor avec un corps de jeune fille; à l’expérience de la mort, le texte oppose l’expérience sexuelle; à la déshydratation et l’assèchement des corps dans le wagon, le texte oppose une relation sexuelle dans un lac, « comme si toute défloration d’une fille ne pouvait avoir lieu que dans l’eau » (Fleischer: 318). À l’animalité à laquelle est réduit le corps dans le wagon à bestiaux, le texte oppose donc « ce qu’il peut y avoir de joliment animal entre une fille et un garçon » (Fleischer: 153). Au regard d’un officier SS qui photographie Sàndor dans le wagon, ce « chien féroce » (304), le texte oppose le regard d’un chien lapant de l’eau, surprenant Sàndor et Anett au moment de leurs ébats (191). La mort n’est d’ailleurs pas très loin, car de retour à la maison de la jeune fille, Sàndor et elle aperçoivent le grand-père d’Annett, mort dans son fauteuil, et devant lui ils poursuivent leurs rapprochements sexuels : « Cette première nuit accumulait sans violence deux expériences premières : celle du sexe et celle de la mort. » (Fleischer: 140.)
La manière dont se déploient les signifiants de l’événement de la mort dans Moi, Sàndor F. n’est pas non plus sans rappeler la logique du rêve élaborée par Freud dans son célèbre ouvrage L’Interprétation du rêve (2010 [1900]). Le rêve condense plusieurs représentations parfois contradictoires, et l’intérêt du rêveur est déplacé sur des représentations moins chargées d’affects, de sorte que ce sont certains détails marginaux qui portent la plus grande charge symbolique12. Une forme de métonymie opère donc dans le rêve, qui permet à un souvenir refoulé — dont la vue telle quelle serait trop violente pour le sujet — de parvenir à la conscience en se « déguisant ». Un élément chargé d’affect peut ainsi être représenté par un élément en apparence moins important, mais qui concerne un événement marquant (par contigüité spatiale ou temporelle). Bien sûr, un texte littéraire est le fruit d’un travail conscient et ne peut être en tout point comparé au travail du rêve; on peut tout de même tirer de cette méthode d’interprétation une certaine éthique de la lecture dans laquelle le signifiant prévaut sur la signification. La scène où Fleischer évoque le plaisir qu’avait son oncle à faire passer son train électrique sur les sépultures de ses animaux de compagnie condense en une représentation le train comme jeu d’enfant et le train comme origine de la mort, par exemple. Chaque évocation de la maison aux murs bleus convoque à rebours le bleu du corps meurtri, piétiné. Chaque évocation animale sous-tend la condition de Sàndor dans le wagon à bestiaux, etc. Chaque trait du récit, même s’il est évoqué dans le texte « en l’absence de toute ébauche de la figure principale » (Fleischer: 23), sous-tend l’événement de la mort. Nous savons d’ailleurs qu’Alain Fleischer n’écrit pas ses textes, mais les dicte plutôt à sa compagne qui, elle, les retranscrit simultanément à l’ordinateur : « Je n’ai jamais de plan, jamais de notes, je ne prépare rien, je suis incapable de projeter un livre. […] Dans la situation de devoir dicter, m’apparaît ce que j’ai à dire », confie Fleischer en entrevue (cité par Henric, 2009). Ceci reforce l’idée que les images présentes dans le texte sont le fruit d’un flot de pensées qui trouve son organisation non pas dans un geste de travail textuel, mais dans un travail de la parole.
Moi, Egon Schiele
D’autres informations qui appartiennent au savoir de Fleischer (de ses lectures historiques, des fictions qu’il a lues et vues) s’inscrivent dans cette circulation des signifiants et modulent l’histoire de Sàndor. L’homme aperçoit au cou d’un SS un appareil photo Leica II qui lui rappelle l’appareil qu’il aurait possédé, plus jeune, « de la même marque et du même modèle » (Fleischer: 239). Ce n’est pas anodin, le co-fondateur de l’industrie Leica, Ernst Leitz, est reconnu pour avoir aidé des Juifs à s’échapper de l’Allemagne par train durant la Seconde Guerre mondiale, sous prétexte d’affecter des employés à d’autres usines. Cet appareil est aussi celui avec lequel Sàndor F. aurait photographié sa sœur nue lors d’un voyage à Berlin. Durant ce voyage, et avant de photographier sa sœur, le garçon se serait précipité dans une salle de cinéma où il croyait avec son appareil pouvoir immortaliser les images de femmes nues à l’écran; un employé, « le diable en personne » (Fleischer: 263), l’aurait surpris et lui aurait proposé plutôt de lui acheter des photographies pornographiques. Sàndor aurait conservé dans ses poches ces images « de jeunes femmes au corps disgracieux, prisonnières d’un triste sort » (Fleischer: 269). Tous les stratagèmes qu’il élabore pour que les clichés ne soient pas découverts ne sont pas sans rappeler les photographies prises clandestinement sur les camps et dont les pellicules ont dû être dissimulées pour être montrées au grand jour — photos parmi lesquelles on retrouve justement des images de femmes nues se dirigeant vers une chambre à gaz. L’obsession de Sàndor de photographier sa sœur nue trouve une autre explication qui nous mène du côté de la biographie d’Egon Schiele. Fleischer — qui est également photographe, et qui a publié un essai portant sur la photographie pornographique (Fleischer, 2000) — imagine son oncle lors d’un voyage avec sa sœur Lenke visiter une galerie d’art et être frappé « de l’émotion la plus forte et la plus mémorable » (Fleischer: 98) par la vue de deux tableaux d’Egon Schiele : un autoportrait et un nu féminin, celui de la jeune sœur du peintre.
Il s’avère qu’un an avant la parution de Moi, Sàndor F., Fleischer publiait un petit essai entièrement consacré à la dernière toile de Schiele (2008), fasciné par celle-ci comme par les dernières minutes de la vie de son oncle, l’image absente dont il se fait lui-même le peintre13. Schiele est mort à 28 ans (en 1918) de la grippe espagnole : dans le roman, lorsque Fleischer en fait mention, il parle plutôt d’une mort à 27 ans (Fleischer: 100) et fait ainsi coïncider le destin du peintre avec celui de son oncle, mort à cet âge. Fleischer ouvre cet essai sur Schiele en proposant que « [t]oute existence humaine est comprise entre des premières et des dernières fois » (2008: 6), prenant pour exemple la première et la dernière relations sexuelles d’un individu. La lecture que Fleischer propose de l’œuvre de Schiele est en quelque sorte orientée par les événements de la Shoah, signalant au passage que le peintre a été admis à l’Académie des beaux-arts de Vienne dans les mêmes années où l’on y a refusé à deux reprises l’admission d’Adolph Hitler; Fleischer signale aussi la passion de Schiele pour les trains — « la ligne du dessin devenant à sa façon une ligne ferroviaire » (Fleischer, 2008: 50). Dans cet ouvrage, surtout, on apprend que Schiele utilisait sa jeune sœur Gerti comme modèle pour ses toiles. En voyage avec Egon, retournant sur les traces du voyage de noces de leurs parents, elle posait nue dans leur chambre d’hôtel, tout comme Lenke pour son frère Sàndor. Fleischer présente ainsi la double transgression qui consiste pour Schiele et sa sœur à imiter la relation de leurs parents : « La fille a-t-elle pris la place de sa mère auprès du père, dont la place était prise par le fils, par le père? » (2008: 55); « À la recherche de quel passé, de quel secret dans l’histoire familiale, le frère et sa petite sœur se sont-ils lancés dans une étrange entreprise doublement incestueuse […]? » (54.) Les biographes de Schiele refusent apparemment « d’imaginer un quelconque passage à l’acte dans les relations sexuelles » (55) entre le frère et la sœur; Fleischer soutient pour sa part cette hypothèse, s’appuyant sur son interprétation d’événements biographiques (56), mais surtout sur sa subjectivité propre :
Sur ce débat sera préféré ici, à la prétendue objectivité de ceux qui refusent la version de l’inceste, un sentiment personnel, subjectif, de connivence, inclinant au contraire à y ressentir la réalité des faits et des actes. Car il y a plus d’espoir de vérité, ou tout du moins de lumière, dans la perception des similitudes entre les situations et les destins, de la complicité des caractères et des pulsions, que dans les jugements dictés par la différence et transformant celle-ci en critère de neutralité. (Fleischer, 2008: 56-57.)
Dès lors, Fleischer transgresse dans cet essai une pudeur qu’il condamne chez les biographes, et il publie un an plus tard Moi, Sàndor F. Ce dernier effectue un pas de plus dans la transgression en donnant une forme à l’espèce de désordre filial14 qui l’intéressait déjà chez Schiele. Dans ce roman, il transfigure le rapport artistique et incestueux entre Schiele et sa sœur pour l’attribuer à Sàndor et la sienne, mais aussi en inventant une narration fonctionnant sur le mode de l’inceste, de la fusion de l’oncle et du neveu au sein d’un même « je ».
À propos de Moi, Sàndor F., Dominique Viart écrit : « Il y a sans doute un certain scandale à s’installer ainsi dans la vie et la mort d’un autre. Mais le scandale serait aussi de laisser cette vie et cette mort se dissoudre dans le silence qui les cerne. » (Viart, 2011 : 28.) Dans le but de ne pas laisser tomber l’histoire de son oncle dans l’oubli, Fleischer écrit Moi, Sàndor F., un roman qui se débat avec l’impossibilité de raconter. L’œuvre ne cherche pas à nous tromper, mais nous trompe malgré tout, dans la mesure où elle produit un langage devant lequel on se retrouve sans repères. Fleischer tente de restituer une mémoire, de construire un récit, une vie, avec d’autres moyens que ceux de la reconstitution historique, que l’on nommerait sans doute, à tort, une écriture « fiable ». L’écriture est pour Fleischer « l’impossible cicatrisation d’une blessure toujours à vif » (Fleischer: 99).
Le vécu d’un événement traumatique ne se déploie pas en trois temps (passé, présent, futur), mais a plutôt à voir avec un présent qui fait retour, un présent qui ne passe pas. Il s’agit pour Fleischer d’inventer les modalités d’une énonciation capable de rendre justice à ce dérèglement du temps, à l’éternel retour d’un événement qui fait toujours question et qu’aucun récit ne peut figer. Alors qu’on a souligné maintes fois « l’absence de sens » de la Shoah (Agamben, 2003: 29)15, des œuvres comme celle de Fleischer nous montrent que la quête obstinée des romanciers contemporains à l’égard des événements n’est pas tant de fournir des explications que de produire du sens à partir d’eux. Comme le dit Giorgio Agamben dans Ce qui reste d’Auschwitz : « Dire qu’Auschwitz est “indicible” ou “incompréhensible”, cela revient à eupemein, à l’adorer en silence comme on fait d’un dieu; cela signifie donc, malgré les bonnes intentions, contribuer à sa gloire » (2003: 35). Inventer un langage « suspect », de nouvelles modalités d’écriture susceptibles de tordre les registres du réel et de la fiction apparaît comme une nécessité chez les auteurs contemporains qui cherchent à transmettre une histoire dont les témoins commencent à manquer. « Un destin tragique, interrompu prématurément, laisse le sujet dans un éternel présent de son drame, sorte d’éclairage fixe ou d’image arrêtée » (Fleischer: 56), écrit Fleischer. Ainsi peut-on concevoir Moi, Sàndor F. comme une tentative de défiger l’image, de produire un savoir malgré tout sur la vie de son oncle, quitte à inventer, quitte à tromper.
- 1. DELISLE, Michael. 1987. Les mémoires artificielles. Trois-Rivières : Écrits des Forges, 58 p.
- 2. « C’est grâce à cette chevalière que l’histoire des derniers moments de mon oncle Sàndor est parvenue jusqu’à nous. Dans le wagon où il agonisait, il a pu confier cette chevalière à un de ses compagnons d’infortune, dans l’espoir qu’elle parvienne un jour sous les yeux de quelqu’un qui la reconnaîtrait. » (Fleischer cité par Savigneau, 2011: 8)
- 3. Alain Fleischer confie d’ailleurs avoir hésité durant un an avant de répondre à la requête de Jean-Luc Moreau lui demandant de rédiger un livre pour sa collection « Alter Ego », qui propose des autobiographies fictives : « Il fallait que l’exercice de la commande devienne une nécessité pour que je puisse y répondre. » (Fleischer cité par Savigneau, 2011: 8)
- 4. Cet article n’entend pas démêler les rapports complexes et étroits entre l’écriture de l’Histoire et l’écriture de fiction, qui constituent un champ de recherche en soi. On pourra se référer aux travaux de Michel de Certeau (2002).
- 5. Marianne Hirsch poursuit : « Mais ces expériences lui ont été transmises de façon si profonde et affective qu’elles semblent constituer sa propre mémoire. Le rapport de la postmémoire avec le passé est en vérité assuré par la médiation non pas de souvenirs, mais de projections, de créations et d’investissements imaginatifs. Grandir avec l’héritage d’écrasantes mémoires, être dominé par des récits qui ont précédé sa propre naissance ou sa propre conscience fait courir le risque que les histoires de sa propre vie soient elles-mêmes déplacées, voire évacuées, par nos ascendants. C’est être formé, bien qu’indirectement, par des fragments traumatiques d’événements qui défient encore la reconstruction narrative et excèdent la compréhension. Ces événements sont survenus dans le passé, mais leurs effets continuent dans le présent. C’est là la structure de la postmémoire et le processus propre à sa génération. » (Hirsch, 2014: 205.)
- 6. Outre Moi, Sàndor F., Viart mentionne le cas de Wagon d’Arnaud Rykner (2010), celui de Jan Karski de Yannick Haennel (2009), ainsi qu’HHhH de Laurent Binet (2009).
- 7. Dans le rabat du livre de Fleischer, on peut lire : « Alter Ego veut offrir à des écrivains cette aventure de l’autobiographie fictive comme une équipée littéraire tout aussi exotique qu’intime. Un voyage par l’altérité pour atteindre les seules frontières qui puissent paraître lointaines aux auteurs, celles disséminées par les contours de leur propre œuvre. »
- 8. Le roman a notamment remporté deux prix littéraires l’année de sa parution : le Prix du roman Fnac et le Prix Interallié.
- 9. La charge envoyée à Yannick Haennel par Claude Lanzmann est absolument sans équivoque : « parasitage », « insultantes platitudes », « élucubrations », autant de termes employés pour désigner ce que Lanzmann conçoit comme la manifestation d’un « culot idéologique […] d’une désinvolture […], d’une faiblesse d’intelligence ». En ouverture de sa lettre ouverte, il écrit : « Les jeunes écrivains du XXIe siècle sont à plaindre : ils vivent dans des temps obscurs, sans repères ni attentes, sans futur déchiffrable, sans rien qui puisse susciter confiance, enthousiasme, engagement total. Les utopies sont mortes, c’est la fin de l’Histoire. Ne s’y résignant pas, ils rebroussent chemin et se jettent voracement sur le siècle précédent, si proche et pourtant si lointain. S’éprouvant coupables de n’avoir souffert de rien — manque intolérable —, ils réactivent et rejouent un passé auquel ils n’ont eu aucune part, transformant en trouvailles tonitruantes ce qui était su et rabâché depuis bien longtemps. » (Lanzmann, 2010: 1-10.)
- 10. « J’ai rencontré László Nemes une demi-heure à Cannes. Il est jeune, intelligent, beau et il a fait un film dont je ne dirai jamais aucun mal. Ce Fils de Saul mérite une place au palmarès. » (Lanzmann cité par Blottière, 2015.)
- 11. « Nous avons dû attendre cinq ans pour qu’une nuit de l’été parisien de 1937 donne à ce soir d’un printemps berlinois la suite unique de nos troubles rêveries avec, non dite mais sous-entendue entre ma sœur et moi, cette devise mélancolique : “Une seule fois”. Je me souviens, j’imagine […]. » (Fleischer, 2009: 292.)
- 12. Dans cet ouvrage (2010 [1900]), Freud propose que c’est en se penchant sur ces détails que peut surgir le contenu latent du rêve et que l’analysant — aidé de l’analyste — peut apercevoir de quel désir le rêve est l’expression.
- 13. Par la voix de son narrateur, Fleischer se compare d’ailleurs à un peintre dans Moi, Sàndor F. : « Je vais écrire comme un peintre qui se consacre à son autoportrait, sans aucune logique dans le choix de la première touche — peut-être la nuance d’un détail à l’arrière-plan, au-dessus de l’épaule droite, avant toute autre couleur. » (Fleischer, 2009: 23.)
- 14. C’est aussi d’un désordre filial qu’il est question dans ce dernier tableau de Schiele, qui fascine tant Fleischer. Schiele peint d’abord ce tableau où il se représente avec un modèle (ou une maîtresse) et l’intitule « couple accroupi ». Quand il apprend que son épouse est enceinte, il ajoute une tête d’enfant sur l’image, vis-à-vis du sexe de la femme. Son épouse et lui meurent de la grippe espagnole et cet enfant ne voit jamais le jour. Ce tableau répertorié sous le titre La famille représente donc Schiele avec une femme qui n’est pas son épouse et un enfant qui n’est jamais né.
- 15. « Je suis très agacé par ces extrémistes religieux qui tentent d’interpréter l’extermination à la manière des prophètes : une punition pour nos péchés. Non! Je ne peux pas accepter cela : c’est son absence de sens qui la rend si terrible. » (Primo Levi, 1997: 219; cité par Agamben, 2003: 29.)