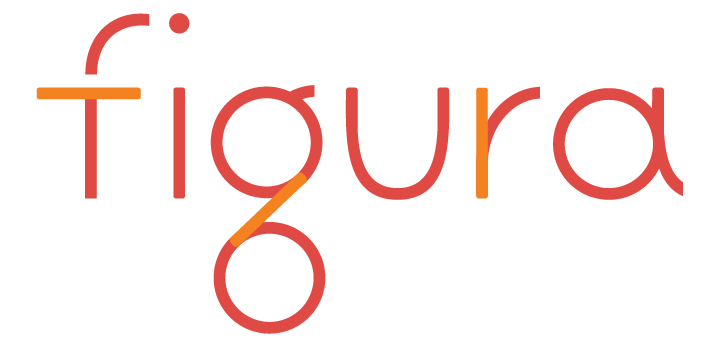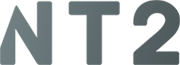Le flâneur que je suis produit des esquisses, des épures,
des fragments épars, souvent tenus au non finito, car
je ne saurai jamais conclure. Je me penche moins sur
la réalité que sur l’existence. Sur le terrain des possibles
humains. Je vise certes le vrai, mais surtout le vivant.
André Carpentier1.
La réflexion qui s’ouvre part d’un embryon de figure, d’une image souche en quelque sorte, celle d’un être qui explore un lieu et qui entreprend de témoigner de son expérience. S’agit-il d’un voyageur, d’un ethnologue, d’un écrivain, d’un flâneur? Cela importe peu. Il convient plutôt de s’interroger sur ce qu’il voit, note ou raconte. Cherche-t-il à rester au plus près des choses ou entreprend-il de transformer ce qu’il a noté en un discours ou un récit? Quelles lignes ses pas ont-ils tracées, quel discours permettent-ils de tenir? Un imaginaire du lieu a tout de même pris forme qui conjoint expérience et interprétation, celle minimale requise pour transformer en signes ce qui a été perçu ou vécu.
L’idée d’une image souche2 rejoint la notion d’une phrase-image, développée par Jacques Rancière. Telle que présentée ici, l’image souche est une phrase qui fait image, une phrase qui vient en appui à une image mentale, un embryon de figure de pensée. Rancière entend par là autre chose que la simple réunion d’une séquence verbale et d’une forme visuelle : « La puissance de la phrase-image peut s’exprimer en phrases de roman mais aussi en forme de mise en scène théâtrale ou de montage cinématographique ou en rapport du dit et du non-dit d’une photographie. La phrase n’est pas le dicible, l’image n’est pas le visible. Par phrase-image j’entends l’union de deux fonctions à définir esthétiquement, c’est-à-dire par la manière dont elles défont le rapport représentatif du texte à l’image. » (2003: 56.) Je me servirai ici de cette notion de phrase-image, non pas tant sur un plan interprétatif, celui privilégié par Rancière, que sur le plan d’une poétique, d’une posture. L’image souche d’un être qui explore un lieu et entreprend d’en témoigner, présentée comme une phrase-image, offre un important potentiel d’actualisation qui conjoint le lisible et le visible, et qui surtout permet de jeter des ponts entre les deux domaines.
La spirale centripète qu’une telle image souche dessine peut susciter de nombreuses études, s’ancrer dans d’innombrables théorisations, les unes sociologiques ou politiques, les autres phénoménologiques, voire esthétiques3. J’entends plus modestement ici limiter mon regard au rapport très précis qui s’établit entre l’expérience initiale d’un lieu par la déambulation et sa prise en charge symbolique, le jeu entre le parcours dans l’espace et le discours qu’il permet de tenir. Et c’est la ligne qui sert de jonction entre ces deux univers. La ligne, c’est-à-dire le tracé dans l’espace, le parcours effectué, le chemin parcouru; mais aussi, la trace écrite ou graphique, la ligne du discours, le fil d’une pensée qui se déploie. Ce double ancrage, dans l’univers physique comme dans l’univers du discours, en fait une notion idéale pour articuler le rapport entre expérience et témoignage qu’un imaginaire du lieu requiert. Pour explorer cette articulation, je proposerai dans un premier temps quelques éléments pour définir un imaginaire du lieu, à partir notamment des trois volumes de flâneries d’André Carpentier; je m’arrêterai, dans un second temps, sur un projet collectif, Hochelaga imaginaire, qui apparaît comme une expérience poétique collective d’exploration d’un quartier. Et tout au long de ce parcours, je m’arrêterai sur les diverses conceptions de la ligne impliquées par un tel imaginaire du lieu.
Un imaginaire du lieu
Chaque jour, s’acharner à arracher un texte au béton.
Mahigan Lepage4.
Hochelaga imaginaire a été conçu dans la perspective de travail d’André Carpentier, qui a fait de la déambulation en contexte urbain une pratique de longue haleine. À partir de 2005, l’auteur fait paraître trois livres de flâneries urbaines. Le premier s’intitule Ruelles, jours ouvrables (2005) et il comprend, comme le titre l’indique, un vaste ensemble de fragments sur les ruelles de la ville où sont consignées observations et impressions. Le deuxième, Extraits de cafés (2010), s’arrête cette fois sur les cafés montréalais, leur quotidien et leurs habitués. Le tout dernier, Moments de parcs (2016), porte sur les parcs et les squares de la ville, tous quartiers confondus. Ces titres composent une œuvre d’une grande minutie qui témoigne à la fois d’un travail soutenu de déambulations dans les rues de Montréal et d’une écriture qui parvient à rendre compte, au gré des jours, de cette expérience. Discret et effacé, tout au long de ses flâneries, Carpentier y apparaît bel et bien comme « le spectateur secret du spectacle des espaces et places de la ville5 » (Tester, 2015: 7).
L’image souche trouve dans la figure de cet écrivain flâneur une forme accomplie. La ligne de ses tracés à travers les espaces urbains et celle de ses écrits, rédigés au fil de l’eau, se rejoignent dans ces trois volumes où l’attention au détail, l’ouverture à l’autre, l’humour, l’empathie et la volonté de ne pas rester en surface ouvrent la littérature à une nouvelle poétique, ancrée dans le quotidien et sa valorisation. Mémoire, expérience et imaginaire du lieu s’y conjuguent de façon harmonique. Comme le précise Carpentier lui-même dans un article où il explique sa démarche, notamment son usage de la note de terrain, « [la] configuration fragmentaire typique des notes de terrain est [la] façon initiale [du flâneur] de composer avec la multiplicité et avec la disparité. Le flâneur écrit en évocation plus ou moins directe ou différée, en une forme de récit plus ou moins immédiate ou rétrospective, tiraillé entre l’évènement vécu et l’évènement de l’écriture. » (2009: 24.)
Les deux plans ne sauraient être plus directement réunis : événement vécu et événement de l’écriture, tracés et traces, parcours et pensées. Ils permettent à l’image souche de se déployer et de se transformer en véritable figure de pensée et, d’un même mouvement, à la ville de s’actualiser sur le plan imaginaire. Pour Pierre Nepveu et Gilles Marcotte, dans leur introduction à Montréal imaginaire, cette interface est essentielle et elle définit l’expérience même que nous pouvons avoir d’une ville.
La littérature et la ville concrète, habitée au jour le jour, se rencontrent dans une zone intermédiaire qui tient à la fois du fait littéraire et du fait vécu : toute la ville est pour une large part imaginaire, et c’est dans un tissu serré (quoique souvent chaotique) de symboles, de métaphores, de noms et de références creusant les profondeurs de la mémoire et de l’histoire, c’est dans cette textualité vivante (où les médias et les divers discours sociaux jouent forcément un rôle essentiel) que Montréal comme toute ville devient davantage qu’un simple lieu ou qu’un pur agglomérat d’objets et de réalités : une entité vivante, jamais loin d’être personnifiée, un chaos appelant une forme, un organisme dont chaque fragment vibre de son être propre mais concourt en même temps à former un ensemble. (1992: 9-10.)
Pour rendre compte des modes de figuration de l’espace, Rachel Bouvet en déplie le processus « en quatre temps, à partir de cette “vue” particulière des mathématiques qui distingue le point, la ligne, la surface et le volume » (2015: 181). Cette géométrie n’est pas seulement un préalable à notre expérience de l’espace, elle agit aussi sur nos figurations et refigurations de tout lieu. Le projet d’André Carpentier exemplifie ces quatre temps. Il s’installe dans un lieu, une ruelle, un parc ou un café, et il reste là, le temps que durent son observation et sa prise de note. Il devient un point dans un espace. Ses descriptions sont parfois de lents panoramiques qui révèlent peu à peu les objets, actions et personnes qui pénètrent dans son champ de vision. Elles se transforment régulièrement en anamnèses, où se côtoient souvenirs d’enfance, lectures passées et réflexions de toutes sortes. Mais ces endroits visités et décrits, ils s’enchainent au fil d’une flânerie dans la ville. Et c’est la ligne cette fois qui est mise en scène. À force de parcourir la ville et de transcrire ses itinéraires sur des pages de carnet, il inscrit des lignes, continues plutôt que brisées, et il fait de ses journées des tracés que l’on peut pister, comme autant de griffures sur une feuille. Ce n’est plus le panoramique, mais le travelling qui caractérise alors son travail (Robin, 2009: 34). Le travail de flâneur et de scribe de Carpentier le conduit aussi à composer un espace complexe, une surface que l’on peut à loisir réinvestir. Sa trilogie des flâneries nous invite à une cartographie imaginaire. Il faut dire que les lieux ne sont jamais identifiés, même si l’on peut en reconnaître certains par quelque détail familier; les fragments ne portent aucune date calendaire : « Plutôt que la durée, écrit-il, ce sont les instants et leurs visions qui m’ont captivé et guidé. » (2005: 17.) Nous sommes laissés à nous-mêmes et nous parvenons à refigurer Montréal à partir de nos propres repères, de notre propre surface de projection et d’inscription.
Ensemble, ai-je le goût d’ajouter, les trois livres de sa trilogie constituent les vecteurs d’un volume où vient se nicher un imaginaire du lieu en acte. C’est un Montréal imaginaire qui apparaît ainsi peu à peu, une ville à la croisée de l’expérience, de la mémoire et de l’imagination. Or, cet espace mental, on peut l’habiter, le développer davantage, le meubler en quelque sorte. C’est ce que le projet Hochelaga imaginaire a entrepris de faire, en visant cette fois non pas la ville entière, mais un quartier précis, en l’explorant ensuite sur un mode collectif plutôt qu’individuel et en utilisant enfin les possibilités techniques du numérique plutôt que les ressources usuelles de la culture du livre.
Suivre une piste
Dans Une brève histoire des lignes, Tim Ingold revient sur les différentes façons de se repérer dans un espace. Il cite un extrait de Playing Dead, une méditation sur l’Arctique publiée en 1989 par l’écrivain canadien Rudy Wiebe. Au cœur de cet essai, nous dit Ingold, Wiebe compare la manière dont les Inuits appréhendent le mouvement et le voyage avec celle de la Royal Navy, à l’époque où elle était en quête du passage du Nord-Ouest.
Chez les Inuits, il suffit qu’une personne se mette en mouvement pour qu’elle devienne une ligne. Pour chasser un animal, ou retrouver quelqu’un qui s’est peut-être perdu, les Inuits tracent une piste linaire dans l’étendue et se mettent en quête d’indices menant à une autre piste jusqu’à atteindre le but recherché. Le pays entier est donc perçu comme un entrelacs de lignes et non comme une surface continue. Les Britanniques, en revanche, « habitués au flux des mers sans pistes, s’orientaient selon des zones » (Wiebe: 116). Conçu par les commandants comme un habitacle mobile, le navire était affrété avant le départ pour transporter l’équipage, et devait suivre un itinéraire déterminé par la latitude et la longitude d’un ensemble de points indiquant la destination souhaitée. À la différence des Inuits qui voyageaient le long des pistes, les Britanniques traversaient à la voile ce qui était pour eux la surface du globe. Ces deux types de mouvements — longer et traverser — peuvent être figurés par des lignes, mais des lignes radicalement différentes. La ligne qui longe est, pour reprendre les termes de Klee, une ligne partie en promenade. La ligne qui traverse est un connecteur, reliant des points disposés sur un espace à deux dimensions. (Ingold, 2011: 100-101.)
Ce qui est mis en scène dans cet extrait, c’est la distinction entre la ligne comme connecteur et la ligne comme promenade, ou plus précisément la ligne comme connecteur entre des points prédéterminés, qui établissent ultimement un parcours, et la ligne comme promenade ou mise en relation de lignes qui viennent architecturer un territoire, le construire comme lieu de vie.
Cette conception de la ligne comme connecteur revient à traverser un territoire ou un quartier, sans jamais l’habiter. La ligne comme promenade permet au contraire de les occuper, de les habiter. La première conception est efficace, elle permet de se rendre à bon port, de progresser sans dévier. Ce sont les rails du métro de Montréal, qui traversent par exemple un quartier comme Hochelaga : Préfontaine — Joliette — Pie-IX, trois stations, trois points reliés par une ligne qui ne dévie jamais (et heureusement d’ailleurs) de son cours. L’efficacité de la seconde se calcule en termes non pas de rapidité ou de rendement, mais de densité, voire d’irisation. Travailler à se forger un imaginaire du lieu, c’est occuper un territoire, c’est le parcourir, en suivant des lignes et en adhérant à leur logique relationnelle, les lignes s’inter-reliant en viennent à constituer un tissu. Pour Paul Klee, la ligne « qui se promène librement et sans entrave » est active et dynamique, argue Ingold (2011: 98). Et cette ligne s’oppose à une autre ligne, une ligne pressée :
celle qui veut passer d’un endroit à un autre sans avoir beaucoup de temps pour le faire. […] Chacune de ses destinations est fixée à l’avance, et chaque segment de la ligne est prédéterminé par les points qui la relient. Si la ligne active en promenade est dynamique, la ligne reliant des points définis se caractérise, selon Paul Klee, par la « notion de calme parfait ». Si la première nous entraîne dans un voyage qui n’a apparemment ni début ni fin, la seconde nous met en présence d’un ensemble interconnecté de destinations qui, comme sur une carte, peut être perçu dans sa totalité et en une seule fois. (Ingold, 2011: 98.)
La différence est aisément illustrée par l’opposition entre le trajet du métro, qui traverse un quartier sans jamais l’explorer, et le parcours d’un écrivain flâneur noté sur une carte. Le premier ne dévie jamais, il est un principe déterminé, stable et récurrent. Le second ne fait que dévier d’une déambulation à l’autre. Il est variation. Et c’est cette variation même qui est à la base de ses fonctions heuristiques, car elle s’impose comme un principe de découverte. L’imaginaire d’un lieu se constitue peu à peu, comme les sillons laissés par les déambulations qui se multiplient et se surimposent. Le déplacement par rail donne accès non pas à l’imaginaire d’un lieu, mais à celui, replié sur lui-même, d’un imaginaire du métro, l’habitacle devenant son propre lieu, avec ses propres règles et possibilités de faire et de dire6 .
Se forger un imaginaire du lieu, l’imaginaire d’un lieu, c’est longer une voie, un chemin, une allée. C’est côtoyer, border, arpenter. C’est aussi suivre une piste et écouter son chant. Un chant de piste donc, ce qui est bel et bien une façon de réaliser un potentiel inscrit à même le territoire. Suivre une piste et s’inscrire dans un projet de création à caractère géopoétique, fondé sur une intensification du rapport de l’être au monde (Bouvet, 2015: 9), cela ne peut s’accomplir que si la piste elle-même n’est pas simplement territoriale, mais imaginaire, que si elle est à l’intersection, à l’interface du territoire et de la pensée. Le territoire ne devient un territoire que s’il a été l’objet d’une appropriation, que s’il a été soumis à un processus symbolique. Comme le dit Rachel Bouvet, en parlant du paysage, mais ses propos valent pour tout lieu, « le paysage n’existe qu’à partir du moment où il est “construit” (peint, écrit, pensé, imaginé) » (2016: 106).
Clairement, suivre une piste est une opération double. C’est à la fois déambuler dans l’espace et suivre une forme, une forme déjà établie. Pour Tim Ingold d’ailleurs, « on ne peut pas toujours déterminer avec certitude ce qui distingue une ligne réelle d’une ligne imaginaire » (2011: 71). Ce qui, pour les uns, est un acte de construction du paysage se révèle, pour les autres, une inscription imaginaire. Il en est ainsi évidemment parce que l’imaginaire d’un lieu se déploie dans la tension entre une expérience, une mémoire et un acte d’imagination et de création. S’il suffit qu’une personne se mette en mouvement pour qu’elle déplie une ligne, il suffit que cette même personne tente de la dire, cette ligne, qu’elle entreprenne d’en interpréter la forme et le dessein, pour que la ligne devienne un chant, un chant de piste.
L’analogie aux chants de pistes des aborigènes australiens n’est pas fortuite. À la suite de Tim Ingold, mais surtout de l’écrivain voyageur Bruce Chatwin, qui a donné, le premier en 1987, une interprétation à caractère universel des chants de pistes, on peut faire l’hypothèse que ces chants apparaissent comme un des moyens par lesquels les êtres humains marquent leur territoire, en fixent les limites et la forme, afin de le faire exister sur un mode imaginaire (Gervais, 2014: 36 et passim).
Les aborigènes, dit Chatwin, ne conçoivent pas « le territoire comme un morceau de terre délimité par des frontières, mais plutôt comme un réseau de “lignes” et de voies de communications entrecroisées » (2005: 661). Des voies qu’il s’agit évidemment de parcourir et non de traverser. Pour lui, les chants de pistes constituent « un labyrinthe de sentiers invisibles sillonnant tout le territoire australien » (606). Dans le mythe grec, pour sortir du Labyrinthe, il faut un couple lié par un fil, c’est-à-dire un être qui s’aventure dans le dédale, Thésée, et un autre qui l’aide à revenir, Ariane. Le premier est déambulation, errance dans un espace complexe fait pour s’égarer, une exploration qui ne sait rien de la ligne qu’elle dessine; et la seconde est rappel, notation, un ressaisissement nécessaire. Sans Ariane, le labyrinthe est un espace vacant où l’expérience s’évanouit aussitôt terminée. Or, les mêmes fonctions sont essentielles pour retenir quelque chose de l’exploration de tout lieu. Cela prend un couple lié par un fil : un flâneur qui explore un territoire et un écrivain qui prend note de ce qui a été recueilli. C’est la réunion de leurs actions qui définit un chant de pistes.
Chatwin avait anticipé ce rapport dynamique à la création, déclarant qu’il avait l’impression « que les itinéraires chantés ne se limitaient pas à l’Australie, mais constituaient un phénomène universel, le moyen par lequel les hommes marquaient leur territoire et, en conséquence, organisaient leur vie sociale. Tous les autres systèmes qui lui ont succédé n’étaient que des variations — ou des perversions — de ce modèle originel. » (2005: 907.) Il se plaît d’ailleurs à imaginer des chants de pistes « sur tous les continents, à travers les siècles », et des « hommes laissant derrière eux un sillage de chants (dont, parfois, nous percevons un écho) » (907-908). On peut, à sa suite, proposer que toute création littéraire n’est qu’un subtil chant de pistes, la production d’itinéraires chantés ou racontés nous expliquant qui nous sommes et d’où nous venons, nous inscrivant dans un territoire (culturel et géographique), nous y liant et, en même temps, l’actualisant.
Hochelaga imaginaire
En 2014-2016, les membres de La Traversée, l’atelier québécois de géopoétique, ont participé au projet Hochelaga imaginaire. À la manière de nombreuses autres activités du groupe, le déroulement de cet atelier, qui s’est étalé sur un peu plus d’un an, a permis de diversifier les approches créatrices tout en multipliant les occasions d’explorer le quartier et de dialoguer avec ses habitants. Les textes, notes de terrain, photographies et dessins ont été mis en ligne sur le site web du projet7.
L’objectif d’Hochelaga imaginaire était de déployer un imaginaire du lieu issu de la tension entre expérience et mémoire : expérience de ce quartier montréalais aux frontières relativement stables, dont le nom est symbolique de la ville elle-même; mémoire des strates qui constituent son histoire. Cette double exploration devait permettre de tracer les lignes d’un territoire imaginaire, vaste chant de piste collectif produit au contact d’un milieu de vie urbain 8. L’expérience a pris la forme de flâneries collectives ou individuelles, de cette forme singulière d’énonciation piétonnière (Certeau, 1990: 147-151) qu’André Carpentier a élevée au rang de composante essentielle d’un processus créateur. Chez lui, la flânerie apparaît non seulement comme modalité du parcours de l’espace (telle qu’on la trouve décrite chez Walter Benjamin), mais comme méthode de captation poétique. Comme il le souligne au début de Ruelles, jours ouvrables,
La flânerie engage à conjuguer par la promenade des espaces publics, à zigzaguer sans but, sans calcul, prémuni de son flair, de son acuité, de sa pleine subjectivité, de sorte à enclencher sa fonction de machine à percevoir, aussi à se cogner aux lieux, puisque le corps nous unit aux choses, comme l’écrit Merleau-Ponty. (2005: 16.)
La flânerie est une « façon de foire d’empoigne avec le réel » (2005: 16). Et la contrepartie tracée de cette foire d’empoigne, c’est la note de terrain, l’entrée dans un carnet quelconque d’une écriture, voire d’un croquis. C’est ainsi que la ligne tracée devient trace écrite, flâneur et scribe réunis dans une même activité interprétative.
Interface entre le monde exploré et le texte fini, la note de terrain s’inscrit comme le dépositaire d’une mise en signe de l’expérience. « Ses glanures, précise Carpentier, prennent la forme d’un bricolage d’impressions, de descriptions, de micro-récits. » (2009: 24.) Elle fournit un matériau qui témoigne d’une connaissance immédiate du lieu. S’il y a là le travail préparatoire d’une réflexion à caractère anthropologique, c’est une anthropologie imaginaire qui est à l’œuvre, une anthropologie fondée sur la déambulation, les lignes et les pistes, les réminiscences. C’est un quartier imaginaire qui se dessine à grands traits, un espace frontalier, intermédiaire, entre le vécu et son interprétation nécessaire, voire sa représentation littéraire.
Parce qu’elle permet de rester au plus près de l’image souche d’un être qui explore un lieu et entreprend de témoigner de son expérience, la note de terrain s’est imposée comme l’élément central d’Hochelaga imaginaire. Le site a ainsi accueilli, tout au long de l’année du projet, soixante-six notes de terrain d’une vingtaine d’auteurs, entrées complétées par des conférences, d’innombrables photographies, des articles, des archives audio. Les notes y sont géolocalisées, pour qu’on puisse identifier sur une carte le point de départ du parcours par leur auteur. Les rues mentionnées sont aussi identifiées par des mots clés, de sorte qu’on peut trier les entrées par noms de rues ou de commerces et les lire en mode groupé ou encore suivre à la trace un auteur dans ses pérégrinations. Ce qui est offert aux internautes, c’est un volume, un espace complexe, une construction imaginaire collective qui se déploie sur un canevas balisé par les déambulations des écrivains flâneurs.
Dans Hochelaga imaginaire, certains tentent d’être au plus près des choses et des êtres, attentifs aux traces que ces derniers laissent dans leurs lieux de vie. D’autres explorent le quartier à la recherche de souvenirs et font entrer en résonance leurs explorations du quartier et leur propre mémoire. Certains s’accrochent, d’autres décrochent. Le quartier, ils ne l’habitent pas en pensée; il leur sert plutôt de tremplin pour s’égarer dans les rets de leur propre espace mental. Quoi qu’il en soit, tous entreprennent d’en constituer une version qui répond à leur conception de la littérature et de leur rapport singulier au réel. Ils captent la rumeur du monde et du quotidien, puis la retransmettent sous forme de notes de terrain.
Ces notes sont un lieu intermédiaire, une première strate où sont déposées perceptions, impressions, élaborations préliminaires, etc. Elles ne sont pas du texte brut, car une telle chose n’existe pas, mais une première approximation permettant de témoigner de l’expérience d’un lieu. C’est une première sémiotisation, établie à partir d’un ensemble chaque fois singulier d’interprétants. Ces derniers constituent dans leurs diverses interactions une véritable interface, c’est-à-dire un imaginaire. C’est bien la direction empruntée par Carpentier, quand il explique que :
Le flâneur témoigne d’un imaginaire propre, entendu comme modalité d’après laquelle se fonde le rapport au monde, et comme conscience imaginante et imageante. Un imaginaire comme expression de résistance individuelle et sociale face au pouvoir, qui permet une esthétisation de la vie sociale. Un imaginaire qui se donne entre autres pour fonction de maintenir vivants les faits et gestes d’individus croisés lors de flâneries. Un imaginaire qui s’occupe à décrire, tels qu’ils sont perçus et interprétés, des êtres épars chez lesquels il devine des signes d’une ressemblance. Un imaginaire qui joue son rôle de lieu d’accueil d’une multiplicité d’identités. Un imaginaire guidé par une forme de sympathie et de souci de maintien du lien social. (2009: 24.)
Il faut comprendre le terme d’imaginaire bel et bien comme une modalité de connaissance et de représentation d’un donné quelconque. Il ne s’agit donc pas d’imaginaire au sens de fictionnel, d’irréel, d’un jeu de l’esprit, ni même d’imaginaire au sens d’un ensemble de signes partagés par une collectivité, un imaginaire collectif par conséquent, mais d’un ensemble de traits et de relations permettant d’interpréter une situation et de lui attribuer une signification, quelle qu’elle soit. L’imaginaire, c’est bien là où se croisent toutes les lignes : lignes de pensées, lignes de vie, lignes continues et lignes brisées, pistes et tracés, généalogies, etc.
Hochelaga imaginaire est, en ce sens, non une totalité, mais un résultat intermédiaire, nécessairement incomplet, transmis par bribes et images captées sur le vif, d’une exploration de ce quartier de Montréal. Le flâneur suit une piste dans l’espace concret du quartier, il prend note de ce qu’il a perçu et les deux, la ligne du texte et la ligne du parcours, en viennent à se compléter. Le projet est une tentative, faite sur un mode collectif, d’épuisement d’un quartier de la ville. Non pas qu’un tel épuisement soit possible ou même envisageable, mais il y a là une contrainte, un protocole de création tout à fait productif. Se concentrer sur un lieu, ne réfléchir qu’à un lieu, l’habiter, engage un triple rapport, celui d’une expérience, d’une mémoire et, ultimement, d’un imaginaire de ce lieu.
De lignes en lignes
Les notes de terrain et les chants de pistes nous ramènent à la ligne et à ses modes de connaissance. Car, il y a plus d’une façon de longer une ligne et de construire sur un plan imaginaire un réseau de lignes. Ces lignes, d’ailleurs, sont-elles droites ou courbes, rectilignes ou sinusoïdales, l’expression de la rationalité ou de la tradition et de ses usages, des lignes qui imposent leur ordre ou qui suivent les irrégularités d’un territoire?
Cette opposition entre les deux types de lignes reprend la comparaison entre l’âne et l’homme telle qu’elle apparaît dans les écrits de Le Corbusier, notamment au tout début de son essai L’urbanisme. L’homme, pour Le Corbusier, « marche droit parce qu’il a un but; il sait où il va. Il a décidé d’aller quelque part et il y marche droit. L’âne zigzague, muse un peu, cervelle brûlée et distrait, zigzague pour éviter les gros cailloux, pour esquiver la pente, pour rechercher l’ombre; il s’en donne le moins possible. » (1994: 5.) L’écrivain flâneur est assurément un âne, dans cette métaphore de Le Corbusier. Mais il faut dire que son action consiste non pas à construire un monde et à le policer, mais à l’habiter, à se mouler à cet environnement qu’il découvre, afin d’y déceler une quelconque vérité.
La rue courbe est le chemin des ânes, la rue droite le chemin des hommes.
La rue courbe est l’effet du bon plaisir, de la nonchalance, du relâchement, de la décontraction, de l’animalité.
La droite est une réaction, une action, un agissement, l’effet d’une domination sur soi. Elle est saine et noble. (10-11.)
L’opposition ne saurait être plus franche. Il y a l’homme, d’un côté, celui qui sait maitriser les éléments et les lieux, qui parvient à imposer son ordre à l’univers, ordre symbolisé par la ligne droite; et l’âne, de l’autre, cet être d’habitude qui laisse à l’univers le soin de lui imposer une voie à suivre, un chemin, la ligne courbe symbolisant la nature et ses contraintes. Pour Le Corbusier, le choix est simple, il faut favoriser la droite à la courbe. Nos villes modernes d’ailleurs sont faites majoritairement de lignes droites. Et le quartier Hochelaga ne déroge pas à cette logique. Son territoire est sillonné de lignes droites, les unes parallèles au fleuve, les autres perpendiculaires. Ces lignes construisent un espace de vie à la mesure de l’homme, quelle que soit cette mesure… Et on comprend, dans un tel contexte, que le but d’une géopoétique urbaine actualisée par le projet Hochelaga imaginaire consiste à retrouver les lignes courbes sous les droites, à récupérer les formes de vie et d’expérience des lieux sous les plans rectilignes des urbanistes et des architectes, à déployer un imaginaire du lieu en contrepoint aux plans et devis officiels. Sous les tracés établis par les connecteurs se profilent les figures d’un imaginaire du lieu.
L’écrivain flâneur sait se libérer des lignes droites, il porte en lui un âne et il explore les ruelles, les parcs et les quartiers, ces lieux de vie qui échappent à la logique rectiligne des urbanistes. Son écriture n’est pas l’expression d’une volonté de puissance, mais la transcription d’une écoute flottante fondée sur une ouverture au monde et à ses diverses voix. L’écrivain flâneur, c’est un museur qui déambule pour ainsi dire le museau en l’air. Ses déambulations sont faites de superpositions et de coïncidences, de ressemblances et de suppositions, d’étrangeté dans l’ordinaire quotidien, du passé dans le présent. Et c’est en créant des amalgames personnels où expériences et souvenirs s’imbriquent qu’il recrée peu à peu un imaginaire du lieu, celui que les notes de terrain, images et dessins viennent concrétiser.
Dans cette dialectique de Le Corbusier, il manque un troisième terme que l’allégorie de Nietzsche « Les trois métamorphoses », insérée dans Ainsi parlait Zarathoustra, permet de cadrer. Cette allégorie est une mise en tension de trois personnages conceptuels (Deleuze, 1991: 64 et passim) qui permettent de saisir les « métamorphoses de l’esprit : comment l’esprit devient chameau, comment le chameau devient lion, et comment enfin le lion devient enfant. » (Nietzsche, 1903: 33.) Sans contredit, l’âne de Le Corbusier est le chameau de Zarathoustra, et l’homme est le lion. Mais, il est stérile d’opposer l’un à l’autre, le chameau au lion, il faut un dernier terme qui vient dynamiser le tout, ce que la figure de l’enfant permet de faire. Elle fait la synthèse de ce qui fait la force de l’un et de l’autre. Or, la figure de l’enfant sert de matrice à la définition de l’écrivain flâneur. Si l’âne chameau est soumis au réel, et si l’homme lion soumet à son tour le réel, le construisant à son image et selon ses propres règles, tout en lui étant lié, l’enfant flâneur, quant à lui, se libère du réel, en dégageant un espace de jeu où tout inventer, tout imaginer. Il se sert de ce réel comme d’un matériau qu’il transforme à sa guise, cherchant ainsi à en faire surgir des figures, qui viendront ancrer un imaginaire, celui en acte que les notes de terrain viennent concrétiser.
À la toute fin de Ruelles, jours ouvrables, après des pages et des pages de déambulations et de descriptions, Carpentier s’arrête sur l’allégorie de Nietzsche :
Tel que maintenant je comprends la chose, dans les premiers temps de sa quête, l’écrivain flâneur se croit convié à une visée descriptive et totalitaire des lieux. Il est alors chameau, dirait Nietzsche; il se hâte dans l’espace en porteur du fardeau de ses valeurs, s’essayant à cristalliser du donné à voir confusément révélé. Observateur compulsif, il obéit à son ivresse, qui est alors son devoir de circonstances. Dans un souci d’inventaire, il noircit des carnets d’observations détaillés… Puis, se détachant peu à peu de l’exercice de la tâche et de ses buts, se dessaisissant de maintes vérités apprises, renversant certaines de ses convictions, apparemment fondatrices, tendant à se maîtriser par lui-même, il devient lion et se promène en ce qu’il est. Alors il fait fleurir la rhétorique ou suer la métaphore, peu importe, il tente de faire à sa manière que les mots se frottent contre leur matérialité jusqu’à s’incendier… Et pour finir, flâneur rayonnant, il devient enfant; oubliant jusqu’à ce à quoi il obéissait, il n’est plus que son jeu de pas et de mots, et son innocence. Alors il s’affranchit de toutes règles autres que celles de sa propre langue et de son propre processus de fouille. Certes, il éprouve tout choix de mot et, à plus forte raison, tout assemblage comme imparfait, voire trompeur, en tous les cas incomplet; il n’a donc plus d’autre option que de poursuivre ses propres montages jusqu’à plus soif. (2005: 358-359.)
C’est en ces termes que Carpentier reprend l’allégorie de Nietzsche. Il termine sa réflexion en notant qu’on retrouve, par la force des choses, chez les écrivains flâneurs, « des traces du chameau, du lion et de l’enfant » (2005: 359). Il procède ainsi à une traduction des termes, associant ces transformations de l’esprit à des postures, celles de l’écrivain flâneur aux prises avec ce territoire dont il tente de capter l’esprit. La première posture est celle du chameau. Celui-ci traverse l’espace. Il assure la liaison entre deux points. Il met des lieux en rapport. Il dresse des cartes, traverse l’espace et sert essentiellement de connecteur, selon les termes d’Ingold. Il est dans le devoir, le « tu dois », pour citer Nietzsche (33). Il s’épuise dans sa tâche qui est tout entière centrée sur le lieu et sa traversée, l’occupation du territoire par la réitération de sa présence.
À sa manière, le lion ne parcourt pas un lieu, il l’habite. Et il en fait ce qu’il veut. Il le domine. Et en ce sens, il devient spectacle. Il incarne le lieu. Il se moque des cartes, parce qu’il invente ses propres représentations de l’espace, dont il est, après tout, le sujet central, le seul qui compte. Le lion est dans la volonté de puissance et dans le désir de reconnaissance de cette puissance. La ligne n’est pas encore partie en promenade, au sens de Klee noté par Ingold. Elle ressemble plutôt au rayon de la roue de bicyclette qui structure l’espace à partir d’un centre, ainsi confirmé dans son statut.
L’enfant invente des cartes imaginaires. Il est dans l’innocence, dans la fabrique, la création d’un espace nouveau. Entre le « tu dois » du chameau et le « je veux » du lion vient s’insérer le « jouons » de l’enfant. Imaginer vient briser la dialectique entre subir et dominer. Imaginer, c’est imaginer ensemble, parce que les jeux les plus amusants ne se pratiquent jamais seul, mais en collégialité. Et la seule façon de produire un véritable imaginaire du lieu, c’est dans le partage et la coproduction, c’est dans la réunion des regards et des voix. Il s’agit, avant toute chose, d’une ligne de conduite.
L’embryon de figure de l’être qui explore un territoire et entreprend de témoigner de son expérience, l’image souche au cœur de la posture de l’écrivain flâneur, trouve ainsi une expression complète, par la voie d’une triple interprétation de l’intention créatrice à l’œuvre. Si la notion d’un chant de piste a pu donner à cette posture un caractère mythique, et si la note de terrain a pu apparaître comme le processus premier de transcription de ce chant, le rapport au territoire est apparu en bout de ligne comme une dialectique entre trois personnages conceptuels, trois postures articulant les liens entre ressaisissement et dessaisissement, écriture et musement, mémoire et oubli. L’imaginaire d’un lieu n’est jamais qu’une interface instable tout aussi fugace qu’un mouvement de la pensée, mais qu’on parvient à stabiliser temporairement à l’aide de formes et d’écrits.
***
Que nous dit finalement la figure de l’écrivain flâneur sur l’imaginaire du lieu? Elle nous confirme, avant toute chose, qu’un lieu n’existe qu’à partir du moment où il est appréhendé, actualisé par une présence, voire une expérience. Un lieu n’existe pas en soi, mais dans une relation, quelle qu’elle soit. Qu’on le traverse ou l’habite, qu’on s’y perde ou s’y aventure, qu’on en fasse l’objet premier de notre attention ou un arrière-plan discret de nos entreprises, il est cette dimension nécessaire de l’agir humain qui nous pousse hors des potentialités pour rejoindre, comme le veut l’expression, le plancher des vaches. Si l’imaginaire se déploie comme une interface entre un sujet et le monde, établie à partir d’un ensemble d’interprétants, de règles et d’habitudes favorisant le développement d’une relation dynamique entre les deux, l’imaginaire d’un lieu apparaît alors comme une version orientée de cet ensemble, une version locale qui, si elle perd en amplitude, gagne en profondeur et en intensité. C’est, à tout le moins, une version qui accorde aux liens entre mémoire et expérience une portée renouvelée.
Arpenter un territoire, déambuler dans les rues, ruelles et avenues d’un quartier, noter au fur et à mesure ses observations, c’est rendre le territoire signifiant. Et c’est participer à son imagination. Or, comme le souligne Tim Ingold, « l’imagination est toujours l’activité d’un être habitant un monde réel » (2013: 304). Et, en appui à cette assertion, il avance : « Nous n’avons pas besoin de penser le monde pour y vivre, mais nous devons vivre dans le monde pour pouvoir le penser. » (2013: 304.) La figure de l’écrivain flâneur — ou son amorce dans l’image souche d’un être qui explore un lieu et qui entreprend de témoigner de son expérience — permet de mettre en forme cette relation nécessaire. Elle indique aussi que le flux de notre présence au monde peut être scandé, dès lors qu’on choisit de se mettre à son écoute.
- 1. CARPENTIER, André. 2016. Moments de parcs. Montréal : Boréal, p. 105-106.
- 2. J’ai exploré cette idée d’une image souche dans quelques études, notamment dans une analyse de la poétique de Paul Auster dans la première moitié de son œuvre, où la figure embryonnaire d’un homme seul écrivant à sa table de travail s’impose comme image mentale d’une grande puissance et potentialité (Gervais, 2011).
- 3. Comme le mentionne Giampaolo Nuvolati, la figure du flâneur « demeure aujourd’hui d’un grand intérêt en sciences sociales, mais aussi en philosophie, en littérature et au cinéma, puisqu’elle constitue un outil privilégié pour identifier les modes de déplacement et d’exploration des lieux par les individus et les rapports sociaux qui en découlent. » (2009: 7.) La figure a été l’objet de nombreux écrits, depuis ceux de Walter Benjamin, de Georg Simmel, de Guy Debord, sans oublier ceux de Jean Baudrillard, de Michel Maffesoli, de Michel de Certeau, etc. Voir aussi l’ensemble des points de vue adoptés par les auteurs du collectif dirigé par Keith Tester, The Flâneur (Routledge, 2015 [1994]) ou encore l’essai de Jieun Shin, Le flâneur postmoderne. Entre solitude et être-ensemble (2014).
- 4. LEPAGE, Mahigan. 2016. Big bang city. Voyages en mégapoles d’Asie. S. l. : publie.net, « La Machine ronde », p. 29.
- 5. [Je traduis.]
- 6. Un projet tel que De lignes en ligne. L’art discret du croquis de métro, de Nicolas Barberon et Annaïg Placard (Eyrolles, 2015), joue explicitement sur le métro en tant que lieu de vie. Que ce soit dans le livre ou sur le site web, dessinateurs, amateurs et professionnels, sortent leurs carnets et crayons pour croquer sur le vif des scènes et des passagers, faisant des réseaux souterrains leur terrain de jeu et de création.
- 7. Le site web, animé par Benoit Bordeleau et Bertrand Gervais, s’inscrit dans le projet de recherche-création Éléments d’un imaginaire des lieux. Traces et tracés géopoétiques, financé par le FRQSC et offert dans le cadre des activités de La Traversée. Le projet est sous la direction de Rachel Bouvet, Denise Brassard, André Carpentier, Bertrand Gervais, Hélène Guy et Jean Morisset. Un carnet de navigation consacré au projet Hochelaga imaginaire (2017, no 15) offre une sélection de textes du site web.
- 8. Depuis la création de La Traversée, de nombreuses activités valorisant une attitude géopoétique à l’égard du territoire urbain ont eu lieu : huit « retours du flâneur » ont touché à des espaces-thèmes aussi divers que les parcs et squares, les trottoirs, les dépanneurs, la nuit, le matin, les gares, les quartiers et même les centres commerciaux; à cela se sont ajoutés des ateliers nomades, tels que Coureurs de ruelles (2005) et Rives et dérives (2008). Plus récemment, le groupe a fait l’expérience des gares du réseau montréalais de trains de banlieues avec GARES (2011), une œuvre hypermédiatique disponible sur bleuOrange, revue de littérature hypermédiatique.