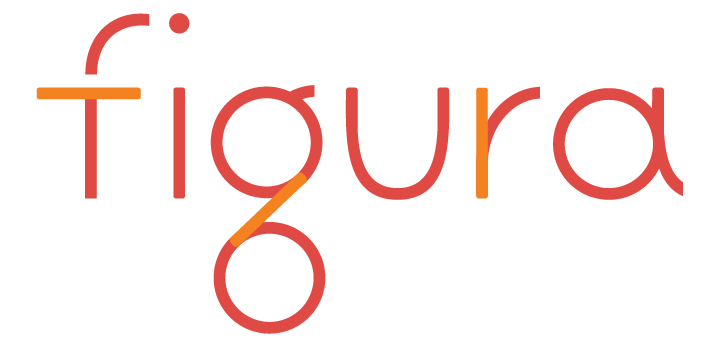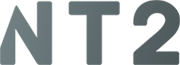Je ne doute pas d’ailleurs que mon histoire ne porte en sa coordination
même la preuve intime de l’exactitude des événements qui la composent.
Mary W. Shelley1.
« La mort d’un enfant est un comble. Je veux dire qu’elle porte à son comble le malheur de mourir qui est le même pour tous », écrit Philippe Forest dans Le Roman infanticide (2010: 127). Ce comble, que Roland Barthes définissait comme une « relation de coïncidence » entre « deux termes (deux contenus) qualitativement distants », autrement dit une incarnation de la figure de l’antithèse (2002 [1964]: 448), est d’autant plus tabou dans des sociétés occidentales qui ont fait de la mort elle-même une infamie, oblitérée du social, disparue des discours (Ariès, 1977; Thomas, 1999 [1978]; Allouch, 2006; Carlat, 2007). Dans ce contexte, la mort de l’enfant apparaît d’autant moins naturelle ou « innocente » (Barthes, 2002: 449). Dans son étude « Family Tragedies. Child Death in Recent French Literature », Gill Rye remarque : « The death of a child is […] what parents fear most. In the family, and in society more generally, a child’s death is almost always perceived as a wrongful death » (2007: 267). Les récits littéraires de cette expérience vécue (Chambaz, 2002 [1994]; Laurens, 2004 [1995]; Forest, 1997; Adler, 2001) entérinent sans exception ce constat d’une mort scandaleuse.
De ce fait, lorsque, après leur publication, cette mort est fictionnalisée, un scandale supplémentaire fait surface, comme si, doublement divulguée, vulgarisée, elle perdait la dignité du réel que lui conférait au moins l’expérience authentique. L’accusation de « plagiat psychique » est alors lancée, et avec elle la diffamation qui l’accompagne, dont l’argumentaire du colloque Diffamation : art et littérature de l’infamie rappelait l’étymologie : « Emprunté au latin diffamatio — qui signifie “divulguer, répandre” — et dans la famille du verbe transitif diffamer — qui vient du latin diffamare, de fama “renommée”2 ». L’anglais a conservé cette nuance entre les deux formes de notoriété, l’une positive, l’autre négative : famous, infamous. Les deux impliquent la réputation : les discours qui précèdent ou suivent un individu. Le fameux et l’infâme signalent une visibilité exorbitante, qui survient ici en proportion même du contexte historique, culturel, social, littéraire dans lequel elle s’inscrit : celui d’une mort qui n’accède plus en Occident à un régime de visibilité; celui d’une histoire littéraire récente qui a déjà son lot d’enfants morts.
Qu’est-il possible alors de divulguer de la mort de l’enfant? d’en faire savoir, d’en répandre? Quand celle-ci commence ou cesse-t-elle d’être infâme dans l’écriture? En m’appuyant sur les arguments échangés entre Camille Laurens et Marie Darrieussecq à la publication de Tom est mort (2007), et entre deux autres écrivains partisans des vertus respectives de la fiction (Pierre Jourde) et du « roman vrai » (Philippe Forest), mais en allant au-delà de la notion et du jugement de « plagiat psychique » déjà abondamment commentés (Strasser, 2012; Barnes, 2015a et 2015b; Robson, 2015), j’aimerais tendre ma réflexion entre ces deux infâmes : la mort de l’enfant, l’écriture de cette mort, afin d’interroger s’ils sont pris ensemble dans un rapport de nécessité. Je me demanderai aussi quels facteurs littéraires intrinsèques seraient conducteurs d’éthique; comment ceux-ci varient le cas échéant du récit à la fiction, s’ils sont spécifiques de l’un ou de l’autre; et ce qu’écrire la mort de l’enfant conserve de profondément polémique au XXIe siècle.
Le tabou de la mort de l’enfant
Dans les sociétés occidentales, la mort est devenue infâme. On a cessé d’autoriser qu’elle soit connue, publique. D’où la superstition qui lui est maintenant associée, dont Philippe Ariès a montré qu’elle est venue d’un refus de sa familiarité, qui était première (1977). Si la mort de l’enfant est un comble, c’est qu’elle est l’antithèse par excellence, gouvernée par une « fatalité intelligente — mais inintelligible », comme l’écrit Roland Barthes (2002: 450). Intelligente parce que la coïncidence fait signe vers une signification : « le comble a précisément pour fonction d’opérer une conversion du hasard en signe » (Barthes, 2002: 449). Inintelligible parce qu’elle réduit à néant la distance entre des parcours jamais censés se rencontrer : la vie naissante, débutante de l’enfant; la mort censée venir au terme d’une vie vécue. C’est en vertu de ce schème de pensée qu’il peut apparaître infâme de l’écrire alors qu’elle n’est pas arrivée. Comme si cela revenait à se jouer de cette superstition, comme si quiconque en était protégé.
Dans Le Bébé (2002), récit en forme de journal des quatre premières saisons de la vie de son fils, qui précède de cinq ans Tom est mort, Marie Darrieussecq relève cette réalité sociologique et culturelle : « Que les enfants soient mortels, c’est ce que l’Occident ne supporte plus. C’est l’ultime lieu du scandale » (2002: 53). Dans ce carnet-journal, qui capture ses impressions de jeune mère d’un premier enfant, elle réfute le tabou mais reconnaît cependant, sous l’angle de la superstition3, le lien de l’écriture au réel :
Aujourd’hui je tuerai autant de bébés qu’il le faut à l’écriture, mais en touchant du bois. Ce n’est pas le tabou qui m’inquiète, c’est la répétition, la malédiction, tout ce qui névrotiquement fait croire à l’ombre portée de l’écrit sur la vie. (Darrieussecq, 2002: 54.)
Si le tabou de la mort de l’enfant — en tant qu’interdit moral ou social — ne suffit pas à empêcher l’écriture, repoussé qu’il est en tant que forme de censure extérieure (« l’Occident »), le pouvoir d’action de l’écriture sur le réel, qui serait la responsabilité de l’écrivain, est dans le même temps attesté et esquivé par le geste superstitieux : « Je commence à dire à mes proches que j’écris un nouveau livre, pour la première fois une version de vie : un livre sur “le bébé”. “Et comment ça se termine?” demande, provocateur, un habitué de mes fantômes. Je ris jaune, et je touche discrètement le bois de ma chaise. » (Darrieussecq, 2002: 136.) L’auteure écrit avant l’expérience, depuis le luxe de pouvoir espérer qu’elle ne connaîtra pas la perte de l’enfant. C’est la logique inverse à celle d’auteurs comme Philippe Forest, quoique ce soit à des écrivains comme lui, remarque-t-il, ayant gagé l’entreprise d’écrire sur leur relation à l’expérience, que l’on demande des comptes éthiques, plutôt qu’aux écrivains de fiction (2010: 15). Cette différence d’engagement est soulignée très justement par Anne Strasser, qui se fonde sur l’essai Rapport de police (2010a), publié par Marie Darrieussecq suite à la querelle avec Camille Laurens :
[O]n remarque que ces deux écrivaines, dans cette polémique, n’ont pas du tout adopté la même posture. Cette différence est déjà celle qui distingue Philippe de Tom est mort. Le premier est un récit strictement autobiographique, la prise de parole de Camille Laurens dans la querelle l’est aussi, que ce soit dans ses articles ou dans son œuvre littéraire Romance nerveuse. Marie Darrieussecq, ayant adopté un « je » fictif pour rédiger Tom est mort, de la même manière maintient une certaine distance par rapport au récit de l’affaire, en choisissant le genre de l’essai, où certes le « je » est également autobiographique, dans le sens où il renvoie bien au nom de l’auteure sur la couverture, mais où la posture d’analyse est celle, distante, de l’étude universitaire, qui cherche ailleurs de quoi étayer sa démonstration. (2012: §28.)
Dans cet essai, Marie Darrieussecq dit se sentir « moralement plus libre dans la fiction » (2010a: 288), notamment vis-à-vis de ses proches, cela lui épargnant une dette à l’égard du réel. Or, ce que suggère entre autres la réaction de Camille Laurens, c’est peut-être que l’on ne peut entièrement se tenir quitte ainsi du réel, sauf à faire justement de la fiction un jeu gratuit. Strasser poursuit :
Le gage d’authenticité, c’est peut-être cela, voir l’écrivain à l’œuvre, aux prises avec son écriture. C’est aussi ce qui distingue radicalement Philippe de Tom est mort. Dans le premier Camille Laurens interroge sa démarche d’écriture, pourquoi, pour qui, comment écrire la mort de son enfant. […] Dans Tom est mort, même si la narratrice dit au début commencer à écrire sur un cahier, et même s’il y a quelques références à cette écriture, il n’y a aucune réflexion sur le travail d’écriture, de questionnement sur la forme à donner. (2012: §42-44.)
Ce n’est pas le cas en revanche dans Le Bébé, qui en tant que non-fiction interrogeait les raisons et le pouvoir d’écrire : « J’écris pour conjurer le sort — tous mes livres : pour que le pire n’advienne pas. J’écris ce cahier pour éloigner de mon fils les spectres, pour qu’ils ne me le prennent pas » (2002: 79). Darrieussecq y énonçait ainsi le « [r]êve d’un livre noir, noir et solaire, le noir jumeau de celui-ci » (2002: 79). On peut alors lire Tom est mort comme la réalisation de ce fantasme : l’inverse fictif du récit d’expérience, la face nocturne de la fiction, le journal de naissance inversé en chronique de deuil. On lisait encore dans Le Bébé : « L’autre livre affleure, l’envers sombre de ce livre, sur les mieux mêmes de nos vies. La fiction, pour dire la totalité. » (Darrieussecq, 2002: 120.) Une telle fiction tirerait donc en vérité sa source du réel, en formerait le complément. Car une attache persiste quant à l’impact de l’écriture sur le vécu : « Écrire sans superstition : éloigner de soi les fantômes. » (2002: 54.) Écrire, en régime de fiction, le comble de la mort de l’enfant, apparaît alors comme le choix ultime d’une liberté de l’auteure vis-à-vis de ce qui pourrait la censurer. Comme le conclut Strasser, de ce point de vue, « [l]e lecteur peut, avec le romancier, jouer à se faire peur, lire la mort d’un enfant “en touchant du bois” ou au contraire affronter la vérité d’un récit autobiographique » (2012: §49).
L’enfant mort : un thème littéraire4?
Ce comble, l’histoire littéraire française en est déjà marquée au sceau de réels enfants morts : ceux de Mallarmé, d’Hugo, et, plus proches de nous, de Chambaz, de Laurens, d’Adler, de Forest, ce dernier ayant en outre proposé dans son premier roman une relecture de l’œuvre des deux poètes à l’aune d’un tel deuil. En d’autres termes, deux historicités concurrentes s’affrontent ici : celle de la production littéraire contemporaine; celle de l’œuvre de Marie Darrieussecq. Eu égard à la première, Tom est mort s’inscrit en faux contre un corpus littéraire qui participe de son contexte de lecture et de réception, d’appréciation aussi. Concernant la seconde, le roman se voit justifié par l’entreprise générale d’une œuvre en cours, qui poursuit ses propres investigations, dessine ses propres tropes. Leslie Barnes observe ainsi, à propos des romans de Darrieussecq, qu’ils sont « especially attuned to the relationship between the traumatic event and its problematic rendering in linguistic form » (2015a: 79). Elle estime que ses romans « repeatedly engage themes of loss, exile, hauntings, and the dissolution of the family » (2015a: 79). Son postulat s’appuie sur l’analyse de Shirley Jordan (2005), selon laquelle Darrieussecq :
has in essence one story to tell. The disappearance of loved ones, solitude and mourning, ghosts and hauntings, broken families and family secrets are the raw materials to which she returns with therapeutic determination, working them up then unraveling them to reintegrate them into new and formally more ambitious patterns. (Jordan [2005: 53] citée par Barnes, 2015a: 89.)
Cependant, comme le cahier manuscrit devient un trope du récit de deuil, et la mère en deuil une figure, l’enfant mort devient un thème, dont le texte dévide les lieux communs : « Les enfants morts, c’est incommensurable. C’est pour ça, je n’ai rien à dire. » (Darrieussecq, 2007: 9.) Dans son article « Psychic Plagiarism », Kathryn Robson remarque aussi la récurrence du thème de l’enfant mort dans la fiction de Darrieussecq :
Darrieussecq’s own earlier novel Bref séjour chez les vivants (2001) traces the reactions of various members of a boy’s family some years after his accidental death by drowning. Darrieussecq herself has noted that figures of missing children “haunt” her fiction, including the child who disappears with her mother in Le Mal de mer (1999), the infanticide in White (2003), and a brother who died in infancy in Le Pays (2005). (2015: 47.)
Dès avant Tom est mort, l’enfant mort apparaît donc comme un thème de l’œuvre, voire l’un de ses thèmes prépondérants. C’est précisément ce que Camille Laurens juge indigne avec Tom est mort, qui égale la fiction à la gratuité, et, quoique s’autorisant de la licence de la fiction, emprunte la forme du journal personnel :
Dans Le Bébé — livre où Marie Darrieussecq traita naguère le « thème » de l’enfant vivant —, elle disait vouloir écrire « sans superstition ». […] Lisant maintenant son dernier roman, où elle exécute, si je puis dire, ce programme, je suis beaucoup moins indulgente. Je ne sais pas s’il faut à la littérature, comme au Minotaure, son lot de chair fraîche, mais je ne peux m’empêcher de penser qu’il est plus facile à ses officiants de sacrifier des enfants quand ce ne sont pas les leurs, et […] de se libérer de superstitions ridicules en touchant le bois de leur berceau plutôt que celui de leur cercueil. (Laurens, 2007b: 9.)
Pour une défense de la fiction, il apparaît pourtant juste de déclarer que : « Imaginer, c’est blasphémer. C’est s’autoriser à se mettre à la place de l’autre, y compris quand cette place est invivable : quand elle est, comme on dit, inimaginable. » (Darrieussecq, 2010a: 266.) Et la mort de l’enfant est l’inimaginable par excellence, comme le souligne Gill Rye (2007: 267). On conçoit dès lors l’attrait, pour un auteur, de cette expérience-limite (Robson, 2015: 48). Il n’en demeure pas moins que la fiction opère ici un double décrochement de la réalité : réalité des publications sur l’arrière-fond desquelles elle voit le jour; réalité de l’expérience vécue de leurs auteurs. Si l’historicité de l’œuvre romanesque la justifie, cette historicité contextuelle met en cause, sans surprise, sa légitimité, voire sa nécessité.
Marie Darrieussecq remarque dans Rapport de police : « S’il y a écriture, la fiction devient un équivalent-monde. La fiction — témoignage de l’imagination — devient vraie. Et il n’y a plus de frontière valide entre fiction et non-fiction. Il n’y a plus que des livres — ou des faux livres. » (2010a: 254.) Hypothèse alors : et si le roman de Marie Darrieussecq était l’un de ces faux livres, construit artificiellement de toutes pièces par les tropes du récit de deuil? Comment évaluer de l’extérieur la nécessité d’un livre, interne au livre, ou à son auteur.e? Si des romans autobiographiques peuvent ne pas être à la recherche d’une vérité de l’expérience, mais se calquer simplement sur la demande médiatique d’exposition, d’exhibition — comme ceux que dénonce Pierre Jourde dans sa défense d’un roman d’imagination (2011) —, peut-on envisager qu’existent symétriquement des fictions qui sonnent faux dans leur approximation du réel, leur prétention à imiter le vécu? Ou qui mettent bien davantage en jeu le moi moi moi dénoncé par Jourde, que les récits d’expériences réelles assumant leur « je »? Si l’autobiographique n’est pas un gage de vérité, la fiction ne saurait, à l’inverse, être un gage d’inventivité. Il faut plutôt reconnaître qu’il est tout aussi possible d’échouer à rendre vivante une fiction.
De ce point de vue, le « roman vrai » (2011) de Forest met en perspective les possibles de la vie, selon la vertu exacte que Jourde attribue à la fiction (2011) : imaginer ce qui pourrait, aurait pu, être, avoir été, dans le passé comme dans l’avenir — c’est d’ailleurs ce que continue à faire toute l’œuvre romanesque de l’auteur de L’enfant éternel (1997). Ainsi sans cesse la ligne de démarcation entre autobiographie et fiction, entre vécu et inventé, bouge, sujette à question. Elle est donc inapte à trancher le dilemme éthique selon lequel on devrait attribuer le primat de la vérité à l’un ou l’autre genre.
Place du livre dans la vie de l’écrivain
C’est là où intervient l’épineuse question de la place du livre dans la vie de l’écrivain. Chez Chambaz, Laurens, Forest, Adler (qui ont écrit sitôt après le décès ou beaucoup plus tard), le livre ponctue le vécu. Il l’entérine et l’enrichit, le crédite et le signe, valide son existence — non au sens où il le rachète ou le sublime par la création, mais en ce qu’il inscrit concrètement dans le temps l’avoir-eu-lieu de cet événement : l’enfant a vécu, puis il est mort. Le livre publié prolonge la prière du prêtre au cimetière; le certificat de décès; le registre de l’état-civil. Il ajoute de l’existence et de la longévité à l’enfant mort. Alors que l’enfant est mort pour toujours, l’écriture fabrique cette concurrence : elle aussi va faire exister le livre pour toujours. En lui, il sera possible de retrouver le souvenir de l’enfant, de savoir à nouveau qu’il a vécu. Même lorsque tous ceux qui l’ont connu auront eux-mêmes disparu, il ne sera pas impossible tout à fait d’imaginer que le livre, lui, aura survécu. De ce point de vue, le livre fait quelque chose dans et au réel : il y contribue selon son propre régime concurrentiel. La publication assure littéralement à l’enfant une forme d’existence sociale, hors de la sphère intime, comme le montre la fin du texte : « J’écris pour dire Je t’aime. [...] J’écris pour desserrer cette douleur d’amour, je t’aime, Philippe, je t’aime, je crie pour que tu cries, j’écris pour que tu vives. Ci-gît Philippe Mézières. Ce qu’aucune réalité ne pourra jamais faire, les mots le peuvent » (Laurens, 2004: 75). Gill Rye remarque à propos de cette affirmation finale :
Here, the book has a role in the public assertion of baby Philippe’s existence, of his death and of the narrator’s parenthood, as, indeed, Laurens confirms in a recent interview: “Il y avait son nom sur la couverture. C’est banal à dire, mais ça le mettait dans le courant de la vie. Ça le mettait au monde d’une certaine manière.” (Laurens en entretien avec Savary [2003: 21] citée par Rye, 2007: 274.)
Le deuil apparaît pour ces auteurs comme une épreuve centrale, décisive : « comment taire un tel événement qui sera, à coup sûr, le plus grave de ma vie? » (Chambaz, 2002: 11.) Voire : cet événement devient désormais la coordonnée centrale de leur existence — et aussi bien, de leur œuvre, comme on le voit avec celle de Forest, de Toute la nuit (1999) jusqu’au récent L’Oubli (2018), ou chez Laurens avec Cet absent-là (2004); chez Chambaz avec Plonger (2011) et Dernières nouvelles du martin-pêcheur (2014). Comment alors ne pas considérer comme vaine, gratuite, futile, la tentative d’un autre écrivain de vivre cette expérience fictionnellement, sur le mode aléatoire de l’aphorisme, de la prospection, de la pensée séparée de l’expérience? Luxe suprême de qui n’a pas eu à passer par l’épreuve du feu, mais aussi luxe un peu obscène, déplacé, lorsqu’un corpus immédiatement contemporain de tombeaux littéraires dédiés à des enfants réels existe par ailleurs.
C’est ce déplacement de nécessité — l’exploration fictionnelle contre la ponctuation de vie —, qui est perçu comme une absence de nécessité et par conséquent comme une gratuité par ceux qui ont écrit sans avoir eu le choix de vivre l’événement. Rapprochant le roman de Darrieussecq d’autres ayant fait scandale pour leur usage des ressources de la fiction plutôt que de l’autorité du témoignage direct, alors que ce témoignage existe (l’exemple des Bienveillantes (2006) de Jonathan Littell est notamment donné), Niccolò Scaffai formule en ces termes l’impression de gratuité : « Do you not feel the shame of putting the imagination in front of the unimaginable? » (2012: 3.) Cette gratuité est alors ressentie comme une infamie par ces écrivains qui se sont sentis le devoir, l’obligation, la nécessité, parfois au titre de la survie, d’écrire leur expérience. C’est pourquoi une interrogation éthique sur la justesse de l’écriture occupe explicitement les récits de deuil proprement dits (Robson, 2015: 53). D’ailleurs, lorsqu’elle-même écrit à partir de son expérience, Darrieussecq note : « Il me serait désagréable d’enrubanner mon fils de phrases superflues. » (2002: 34.)
Ainsi, lorsque Scaffai remarque que « [the] objection levelled by Laurens at Darrieussecq » pourrait se lire par la question : « What right do you have to tell such a horrible story without having lived it? » (2012: 3), ce qui fait problème est moins, à mon sens, ou pas seulement, « without having lived it », que, je dirais : while others who have lived it already wrote about it. Surtout, en l’occurrence : l’une d’entre eux, l’une des toutes premières, publiée par le même éditeur dans la même maison d’édition (Paul Otchavosky-Laurens, P.O.L). Là est l’insupportable maladresse, la gifle annihilante. Si l’éthique interroge la conduite de la vie, elle a tout à voir avec l’historicité — ici la contemporanéité des deux auteures, la cohabitation de leurs textes au sein du même catalogue. C’est pourquoi je mets en avant la lecture concomitante de ces textes, leur difficulté à occuper simultanément l’espace littéraire. L’événement singulier de la mort de l’enfant, fortement perçu comme unique de par sa nature de comble, se voit relativisé par sa comparaison possible avec une sorte de version fictive concurrente; relégué au rang d’inspiration d’un livre parmi d’autres. La primauté du texte de Laurens, qui rejaillissait sur le souvenir — et au fond sur la seule vie — de l’enfant mort presque aussitôt après sa naissance; la force d’événement de la publication, qui le faisait en quelque sorte exister dans le monde, est déspécifiée, diluée en tout cas dans ce recours possible à la fiction, qui convertit « la mort de l’enfant » en une thématique librement disponible, sans le coût de l’épreuve.
C’est une chose de défendre, comme le fait Pierre Jourde, l’idée que ne comptent pas seuls les livres issus de l’expérience vécue (2011). C’en est une autre de considérer que la fiction peut se prévaloir de la plus grande gratuité, car alors tout se vaut : tout ce qui est produit mérite d’être créé, dans la vision d’une sorte d’égalitarisme des voix, comme il y a un idéal de l’égalité des chances. Mais parce qu’on peut dire quelque chose, doit-on nécessairement le faire?
Il est au demeurant surprenant que, malgré sa défense d’un droit à ou de la fiction, Marie Darrieussecq ait fait le choix en entrevue de révéler un événement de vie pour légitimer son entreprise : « On n’écrit pas Tom est mort sans raison. Mes parents ont perdu un enfant. Il y a eu chez eux une forme de silence que je respecte, admire. Je ne suis pas moins légitime comme sœur que comme mère endeuillée. Il y a une universalité de la douleur. » (Kéchichian, 2007.) Elle revient dans Rapport de police sur cette justification : « Il m’est arrivé d’avoir à invoquer un frère mort pour justifier mon droit à écrire un roman. » (2010a: 254.) La défense de la fiction comme libre produit de l’imagination ne s’annule-t-elle pas dans ce retour consenti vers le biographique? Le roman de Marie Darrieussecq ne prétend d’ailleurs pas jouer ce rôle de concurrence avec le réel. Dans Le Bébé, elle explique que ce texte est moins initié par l’expérience que par la littérature, ce qui n’empêche pas cette inspiration d’être ressentie physiquement avec force comme une injonction éthique :
Ce n’est pas la naissance du bébé qui déclenche ces pages, c’est l’existence d’autres livres et d’autres phrases — toutes faites ou étincelantes. Les questions qu’elles posent sont parfois si justes que l’adrénaline éclate dans ma poitrine, une envie d’écrire aussi violente et neuve qu’enfant, quand je croyais que ce n’était pas permis. (Darrieussecq, 2002: 44.)
Autrement dit, l’enjeu du livre est d’ajouter du discours aux discours, de « définir […] [et de] mettre à jour les liens » (Darrieussecq, 2002: 44). Marie Darrieussecq fait souvent valoir cette compagnie des textes dans son processus d’écriture (2002: 44; 2010b). Le livre existe « pour renouveler la langue, pour fourbir les mots » (2002: 44). Est visée une entreprise de dépersonnalisation par l’écriture, de « dépossession » (2010a: 16), car : « Mon entreprise est de salut public. » (2002: 45.) Dans Rapport de police. Accusations de plagiat et autres modes de surveillance de la fiction, elle explique ainsi que le « pouvoir d’imagination » du romancier « n’est pas de se mettre à la place d’une personne particulière. Préjugé ridicule. Il est d’inventer un personnage fictif qui puisse être l’avatar, idéalement, de tout lecteur. » (2010a: 267.) Cependant, si un « équivalent-monde » est par là idéalement créé (2010a: 254), il faut souligner qu’une différence éthique cruciale préside à la création respective du roman et des récits de deuil, différence qui ressortit moins au genre littéraire qu’elle ne concerne l’historicité même de la relation entre vivre et écrire. Ce fossé entre les prémisses des textes, Camille Laurens le relève d’un simple changement de préposition : « Marie Darrieussecq écrit sur le deuil, et non depuis » (2007b: 28).
Vérité et fausseté de la composition
L’espace fait défaut pour examiner systématiquement la poétique des deux textes, aussi je m’arrêterai sur l’épisode final de la révélation de la cause de la mort de Tom, qui démarque certainement le texte de ses contemporains. Chez Chambaz, Laurens, Forest, on commence avec la mort, sans suspense, sans surprise. Ou avec toute la surprise qu’apporte une telle nouvelle, que l’auteur tente de rendre, sans déroger à la réalité de la perte. Le récit est d’emblée le menu détail des circonstances de cette mort. Parce que celle-ci est perçue avec force comme impossible, l’écriture est convoquée afin de s’en porter témoin, voire de s’en convaincre.
Tom est mort emploie une construction inverse, qui fictionnalise encore davantage la mort, et met tout l’accent sur le vécu de la mère. La mort est mise en scène, comme dans un roman policier, en tant que clé de l’énigme. Sa révélation a pour effet de choquer le lecteur, et de le laisser avec ce choc de l’enfant mort d’une négligence de la mère, banale et bien compréhensible puisque tout le texte a insisté sur son état de fatigue — l’oubli de refermer la fenêtre pour la sieste. Cette issue confère au roman un tour sensationnaliste, et peut-être est-ce l’artificialité de ce comble qui choque dans Tom est mort, car il y est produit de toutes pièces : alors que la narratrice et sa famille viennent de s’installer en Australie, l’enfant tombe par la fenêtre et se tue. Or, ce n’est pas la nouvelle vie ici qui crée le comble; elle fabrique plutôt une causalité logique : la mère souffre du décalage horaire; la maison est nouvelle et elle ne s’y est pas encore accoutumée; dès lors l’Australie devient ce monde à l’envers où les enfants meurent. Mais cette absence de corrélation entre la lecture longue que nous faisons, dans l’ignorance, de l’expérience de deuil de la mère, et la découverte finale, soudaine et sans appel de ce qui l’a causée, contribue à éloigner le sentiment de faire face au partage d’une expérience, tout en accentuant celui d’une composition ludique, qui a œuvré à préparer cette surprise, la réservant au lecteur pour le tout dernier paragraphe :
Je l’avais envoyé à la sieste, il regimbait. J’avais fermé à clé la porte de l’appartement, et les fenêtres, comme je fais quand je veux dormir, et je m’étais allongée, fatiguée, tous ces cartons, trois jeunes enfants, et le décalage horaire, et Stella infernale, et Tom qui dormait mal. J’avais oublié la loggia. Dans la chambre au réveil il y avait Vince, il y avait Stella, il manquait Tom. Dans la loggia la vitre était ouverte, je me suis penchée, et je l’ai vu. (2007: 247.)
Découverte qui semble plus morbide qu’éclatante de vérité; qui pourrait être considérée comme de mauvais goût plutôt que comme le triomphe ultime d’un discernement (ce qui serait le vrai sens d’une « révélation »), ce coup de théâtre final trahit la mise en scène, puisque la narratrice en est l’agente. C’est pourquoi Laurens déclare : « On ne fabrique pas un suspense avec la mort d’un enfant » (2007a: 2). Car cette élucidation finale n’est que pour le bénéfice du lecteur; elle n’a aucune vertu pour la mère-narratrice. Sauf peut-être à la concevoir comme une sorte de reconnaissance ultime à laquelle la mère se livrerait enfin, dix ans après le fait; d’aveu consenti à soi-même de ce que l’enfant est mort, et mort par sa faute involontaire — sa négligence. C’est ce que postule Émilie Brière dans sa thèse de doctorat :
Dans Tom est mort, il n’est pas de mystère sur la nature de l’événement devant lequel langage et parole semblent s’abîmer. Le titre du roman laisse deviner qu’il s’agit du deuil de Tom; la quatrième de couverture précise qu’il avait quatre ans et demi lorsqu’il s’est éteint. De suspense, il n’y en a pas, hormis les circonstances dans lesquelles le drame survient — or la narration ne les entoure pas d’une aura de mystère. Au contraire, elles sont données pudiquement à la toute fin du récit, dans un style aussi peu pathétique que ces circonstances sont triviales. (2011: 171-172.)
Ma lecture est inverse : elle postule que le titre a quelque chose d’à la fois grandiloquent, par son effet d’annonce, et de ludique, par son allitération; tandis que la chute du texte constitue nécessairement un lieu dramatique. C’est ainsi « in the face of a subject too atrocious and too real to be put in story format » que se pose « [t]he question of an ethic of shame » (Scaffai, 2012: 4). De par cette composition, curieusement, c’est la scène de mort de l’enfant qui est élidée, puisque figée en une image frappante et définitive qui ne sera plus suivie d’aucun commentaire, laissant le lecteur face au silence. Les récits contemporains sont au contraire abruptement réalistes dans leur description — leur prise en charge — du corps mort et des derniers moments, précisément parce qu’ils placent tout leur effort dans le fait d’énoncer, d’articuler cette mort scandaleuse, comme l’a montré la thèse d’Émilie Brière (2011). Cet évitement ne saurait être mis au compte de la pudeur, puisque nombre d’autres images ne nous sont pas épargnées, telle celle du processus de crémation (Darrieussecq, 2007: 80-81). La fiction apparaît comme une dérobade, un jeu de composition, et un inventaire des possibles.
Rêver les possibles? Un format inventaire
Ce que la fin de Tom est mort illustre, avec son énumération, c’est la tendance inventoriale du roman, tendance saisie, même si ce n’est pas son intention, par ce commentaire de l’éditeur Paul Otchakovsky-Laurens :
Alors va-t-on reprocher à Marie Darrieussecq de décrire dans son roman des moments, des sentiments et des pensées dont on sait qu’ils sont inévitables dans ce malheur qu’est la perte d’un enfant? Ou de tout être cher? Oui, il y a des funérailles! Oui, il y a la question qui se pose d’un autre enfant à avoir, et le désir de fuite, et cette impression que le corps maternel est devenu une tombe, entre autres souffrances. (Otchakovsky-Laurens, 2007.)
Si cette dimension probabiliste, statistique est peut-être inévitable dès lors qu’on aborde le deuil en tant que thème, la lecture du roman de Darrieussecq donne pourtant l’impression à plusieurs reprises d’une récolte de données, comme avec le choix de l’urne (97-98) ou les propos sur la compagnie d’assurance (58-69). Comme le rappelle Anne Strasser, ce catalogage des étapes du deuil est relevé par Camille Laurens :
Elle reproche également à Marie Darrieussecq d’avoir sacrifié aux « scènes à faire » pour traiter le « thème » : « la scène avec les proches, ceux qui fuient et ceux qui ne comprennent pas; la scène où la mère se regarde dans un miroir pour tenter d’y apercevoir son fils mort; la scène où les parents tombent sur la photo du disparu… […] » Enfin, Camille Laurens dénonce l’obscénité et le cynisme qui consistent à multiplier « les phrases pathétiques, les détails poignants, les scènes à faire », à se frapper « la poitrine jusqu’à l’insoutenable en criant “Qui peut comprendre?” » et d’aller ainsi « chercher chez son lecteur (sa lectrice) les angoisses et les cauchemars les plus universels », et de « [racoler] ses terreurs enfouies sans grand risque de rater sa cible. » (2012: §10.)
On pourrait arguer que Le Bébé comportait déjà cette dimension de recensement de ce qu’il est possible de dire d’une expérience donnée. Et de même, qu’il incluait le mode fragmentaire ponctué d’astérisques qui, ici, imite le déroulement du texte en entrées fragmentées d’un journal. Toutefois, à ces traits de composition de prime abord similaires entre roman et récits s’ajoutent des variations poétiques cruciales. Si le récit de Laurens et le roman de Darrieussecq sont tous deux écrits à la première personne, Kathryn Robson relève la présence notable dans Philippe d’une adresse à l’enfant, que relaie en finale, de façon poignante, une adresse au lecteur (2015: 53-54), interpellé dans la prise en charge d’une mémoire qui ne soit pas celle des seuls proches, mais puisse faire exister l’enfant collectivement. Dans Tom est mort au contraire, la mère-narratrice est le foyer d’attention omniprésent, l’alpha et l’oméga de ce « récit » qui n’en est pas un, comme le signale la quatrième de couverture :
Un simple récit, phrase après phrase sur un cahier, pour raconter la mort de Tom, quatre ans et demi, à Sydney, en Australie. Tom a un grand frère et une petite sœur, il a un père et une mère. C’est elle qui raconte, dix ans plus tard, Française en exil, cherchant ses mots dans les Montagnes Bleues. (Darrieussecq, 2007.)
Lu côte à côte avec les tombeaux littéraires d’enfants réels qui lui sont contemporains, comment juger intrinsèquement du texte de Darrieussecq? « Tom est mort. J’écris cette phrase. » (Darrieussecq, 2007: 7.) Comment ne pas entendre seulement des phrases après ce début? Voire un phagocytage de la littérature existante, comme avec l’âge choisi de l’enfant, quatre ans et demi, celui qu’avait l’enfant de Philippe Forest lorsqu’elle est décédée? Par son dispositif qui multiplie les signes de l’effet de réel — le « simple récit5 », consigné sans projet esthétique ou idée de composition (« phrase après phrase ») dans un « cahier » —, la fiction imite la réalité, intime l’idée d’un écrit brut d’expérience. On croit avoir affaire à l’effet de naturel qui, au XVIIIe siècle, fit basculer le pathos dans la péjoration, à force précisément de codification, d’outrance dans l’artificialité des dispositifs destinés à émouvoir (Coudreuse, 2013 [1999]; 2001).
Outre cet effet de réel, un effet esthétique est recherché par le titre du roman, avec son allitération et sa presque anagramme entre le prénom et le participe passé, comme si l’enfant et la mort étaient le miroir l’un de l’autre, s’appelaient réciproquement au son d’une justice poétique qui les lierait intimement. Écho de la coïncidence intelligente mais inintelligible de Barthes, fabriquant ici de toutes pièces une nécessité fictive, dans une orchestration savante du comble. Enfin l’impression persiste, délicate à analyser systématiquement, d’un catalogue des états du deuil, suscitée par les occurrences de recherches sur internet mentionnées par la narratrice, incluant les forums de mères endeuillées (Darrieussecq, 2007: 118) ou encore « l’échelle d’évaluation du stress », dont le tableau est reproduit en pleine page et dont la source (réelle) est l’« Association Canadienne Pour La Santé Mentale » (64). Cette impression de revue des tropes des récits de deuil vient aussi de la réflexion sur l’absence de terme spécifique pour le parent qui perd son enfant (67) ou de l’allusion aux commentaires de l’autre parent sur le texte en cours (169), que l’on rencontre dans les textes de Chambaz et de Forest. Enfin la juxtaposition d’autres anecdotes à même de rapporter par analogie ce que ressent la narratrice, comme avec le membre fantôme d’un amputé (68-69), est un autre trait caractéristique des récits vécus de deuil.
Ces épisodes ou scènes, comme les appelle Laurens, semblent alimenter un examen systématique, constituer les éléments d’un répertoire obligé : la critique féroce du « travail du deuil » et de ses étapes psychologiques (9), la perte des repères temporels (16-17), la certitude de l’impossible (20), l’incrédulité et le sentiment d’une mauvaise blague (24), les voies alternatives qui auraient pu être prises (51), l’interrogation sur les derniers moments heureux de vie, qui s’ignoraient alors (54-55), les signes (55, 71, 109), les images qui demeurent (56), le choix du type d’inhumation (80) et des vêtements de l’enfant (81-83), la solitude des parents devant le cadavre de l’enfant (91), la cérémonie funéraire (94), l’émoussement de la mémoire et les souvenirs du disparu qui arrivent encore par lettres (99), le refus social du chagrin (180-181). Autant de tropes des récits de deuil (Snauwaert, 2012) dont l’aspect sériel contribue à l’apparence fabriquée du texte. Ces artifices alors sont-ils le propre de la fiction? Témoignant d’autant mieux d’elle qu’ils sont exhibés, ou systématisés? Si le propre de la fiction est de rêver les possibles, peut-être ces possibles ne peuvent-ils tous cohabiter au sein d’un même texte, comme le cahier des charges d’un discours ayant pour souci de faire le tour d’un thème, sous peine d’en affecter la crédibilité.
Pour conclure
J’espère avoir montré ce que la mort de l’enfant, jugée le comble du malheur, impossible à concevoir, recèle d’intrinsèquement polémique, à plus forte raison dans nos sociétés occidentales qui ont pour l’essentiel banni la mort de leurs discours et de leurs représentations réalistes. Dès lors qu’elle est rendue visible, il suffit de peu pour qu’elle soit jugée obscène. Elle déborde ainsi du cadre plus général consistant à « interroger la possibilité ou l’impossibilité d’écrire à la première personne une expérience que l’on n’a pas vécue » (Strasser 2012: §2) ou à se demander s’il est « interdit d’écrire fictivement la souffrance à la première personne » (Darrieussecq, 2010: 298). Car la mort de l’enfant se prête autrement que toute autre au jugement d’infamie : elle est de nos jours intrinsèquement infâme. Pour contrer ceci, deux solutions semblent seules viables : taire cette mort, non l’oublier mais la recouvrir de silence, de pudeur, comme le conseillait dès l’Antiquité le stoïque Plutarque à son épouse; puis Montaigne à son tour lorsqu’il adressait à sa femme la Lettre de consolation. Ou au contraire la dire dans toute sa vérité : la vérité de l’expérience, que devra tâcher d’atteindre la vérité de la composition.
On peut alors suggérer l’argument inverse à celui d’une défense de la fiction, en proposant que le récit du vécu peut parfois mieux réussir la dépersonnalisation et l’accession à l’universel que la fiction, à plus forte raison lorsque celle-ci met en scène l’univers fermé d’une figure de mère narcissique, qui est à elle-même sa propre référence. Car le « moi » n’est pas l’apanage de l’autobiographie, comme paraît le croire Pierre Jourde. Lorsque celle-ci est une écriture de recherche, c’est bien plutôt le « je » qui en est le pronom, comme dans le « roman vrai » de Philippe Forest. De sorte qu’écrire la vie, cette démarche si problématique si on y réfléchit sérieusement, peut être plus proche de l’exigence d’invention littéraire, que le « roman » qui s’abrite derrière l’appellation de fiction.
- 1. Mary W. Shelley, Frankenstein ou le Prométhée moderne, traduit par Germain d’Hangest. Paris : GF-Flammarion, 1979, p. 84.
- 2. Voir http://figura.uqam.ca/appels-et-offres/diffamation-art-et-litterature-de-linfamie.
- 3. Cet aspect n’a pas échappé à Camille Laurens, qui en commente la légèreté avec une ironie implacable dans « Le syndrome du coucou » (2007b : 9).
- 4. Notons que Philippe Forest a étudié ces figures d’enfants morts de la fiction dans Le Roman infanticide : Dostoïevski, Faulkner, Camus. Essais sur la littérature et le deuil, cinquième volume de sa série d’essais Allaphbed (2010).
- 5. [Je souligne.]